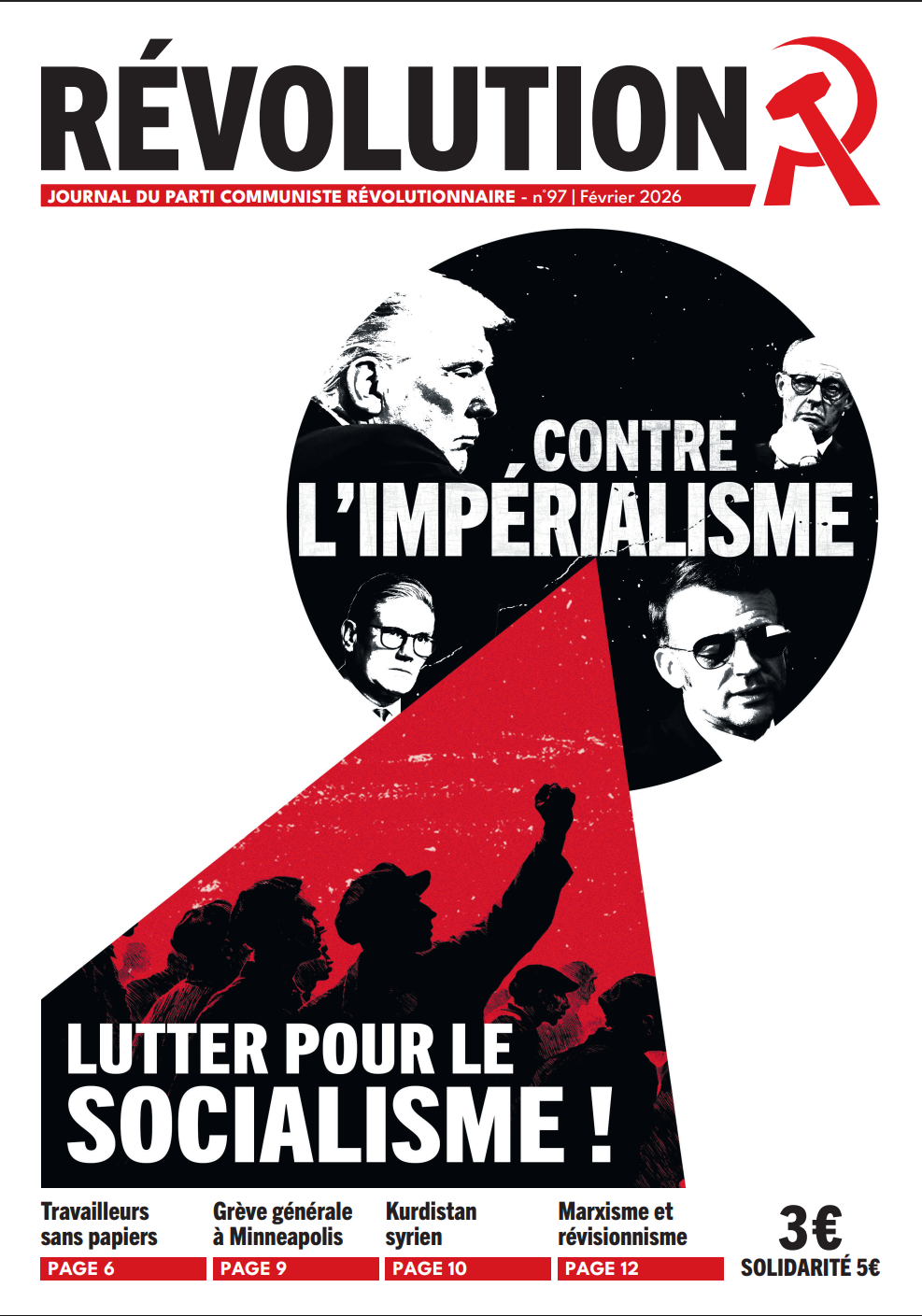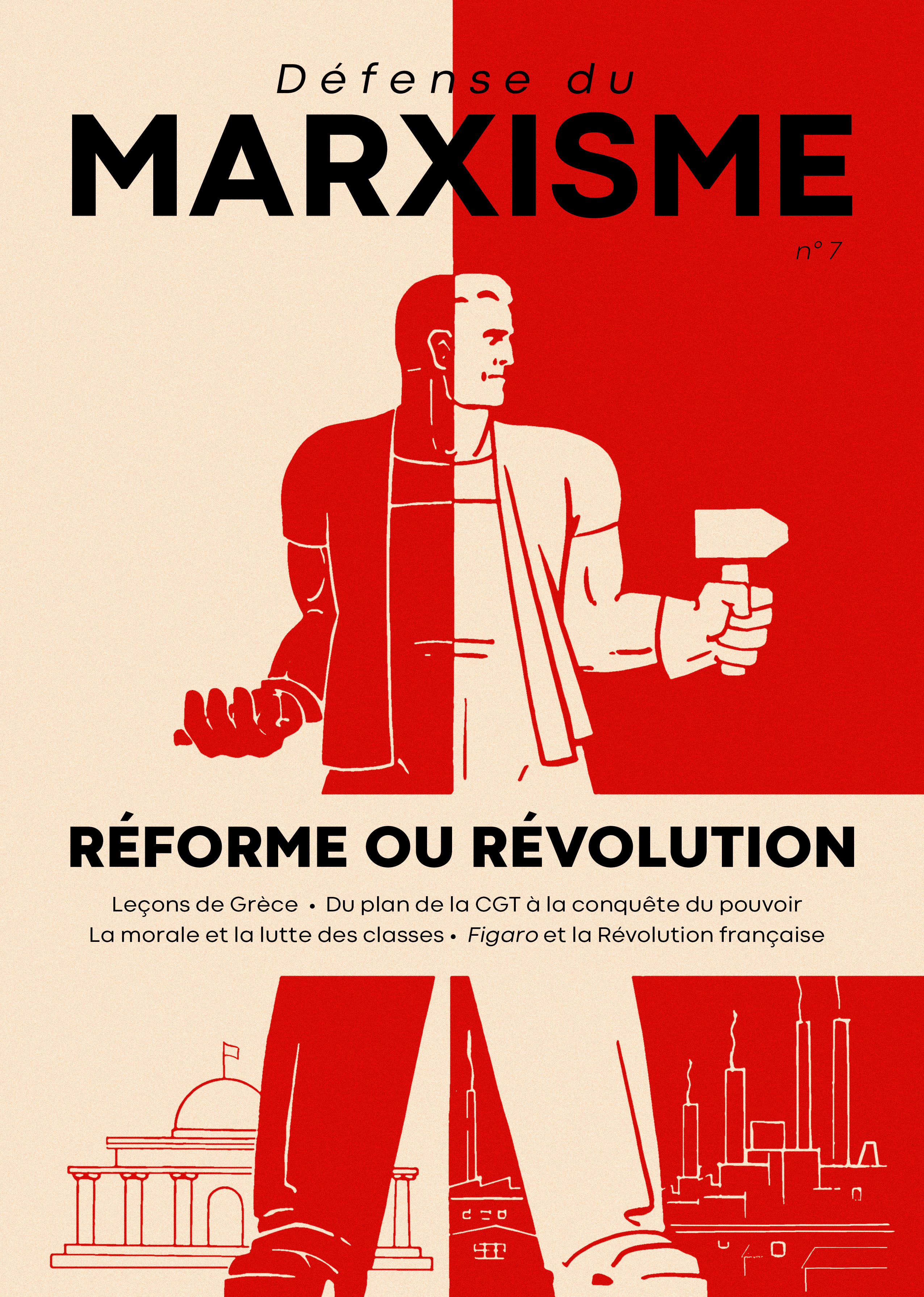Le projet de budget du gouvernement Lecornu vise à faire 43,8 milliards d’euros d’économies, pour ramener le déficit public de 5,4 % du PIB en 2025 à 4,6 % en 2026. Il représente une véritable saignée pour les travailleurs – notamment les plus pauvres d’entre eux.
Son adoption s’annonce ardue. Dans ses négociations, ce que le gouvernement gagne à gauche, il le perd à droite. Pour obtenir une majorité, il lui faudrait rallier les voix du « bloc central », en plus de celles du Parti socialiste. Or, les différentes composantes de ce bloc – Renaissance, Les Républicains, Horizons et le MoDem – ont toutes annoncé qu’elles joueraient leur propre partition. Le texte amendé par la Commission des finances avant l’examen en séance publique n’a d’ailleurs été approuvé que par le groupe Renaissance. C’est donc la version initiale du gouvernement qui est actuellement débattue dans l’Hémicycle.
Pour tenter sans doute de ressouder le « bloc central », Emmanuel Macron a contredit Sébastien Lecornu en affirmant qu’il n’y avait « ni abrogation ni suspension » de la réforme des retraites, mais seulement un « décalage ». Le lendemain, Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a pris la défense du Premier ministre en assurant que « la réforme est bel et bien suspendue », alors que cela supposerait en réalité que le budget ait été adopté, ce qui n’est pas encore le cas !
Au-delà du débat sémantique (« suspension » ou « décalage »), Lecornu cherche avant tout à gagner du temps. Le Premier ministre a renoncé à l’usage du 49.3, prétendant vouloir « redonner le pouvoir au Parlement ». Mais si les discussions échouent, il pourra imposer son budget non amendé par ordonnance.
La réforme des retraites
Le gouvernement a promis que la réforme des retraites serait suspendue jusqu’en janvier 2028, mais cette mesure devra être votée dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), puis reconduite l’année prochaine. Si c’est le cas, la suspension ne reviendrait pas sur le relèvement progressif de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans entre 2023 et 2030, mais en différerait simplement l’application.
Les implications concrètes de la suspension font encore débat. La mesure toucherait les générations 1964 et 1965, qui gagneraient trois mois sur l’âge de départ prévu par la réforme. Pendant la période de gel, la durée de cotisation resterait fixée à 170 trimestres, alors qu’elle devait passer en 2026 à 171 trimestres pour les 1964 et 172 pour les 1965. Sauf changement de plan, la réforme reprendrait ensuite son cours normal à partir de 2028, avec un rattrapage du calendrier initialement prévu.
Le coût de la suspension est estimé par le ministère des Finances à 400 millions d’euros en 2026, puis 1,8 milliard en 2027. En vertu de la règle de compensation, ces sommes devront être intégralement couvertes par d’autres points du budget. Dans une lettre rectificative du 23 octobre, le gouvernement a indiqué que ce coût sera compensé par une hausse des contributions des mutuelles et assurances santé, et par une plus forte sous-indexation des pensions, à 0,5 point sous l’inflation (contre 0,4 point prévu initialement). Résultat : une probable hausse des cotisations des assurés et une érosion du pouvoir d’achat des retraités.
À cela s’ajoute une réforme de la fiscalité des retraités : l’abattement de 10 % sur l’impôt sur le revenu (d’une valeur de 450 à 4399 euros) sera remplacé par un abattement forfaitaire de 2000 euros. Les retraités les plus pauvres pourraient y gagner légèrement, mais les retraites un peu plus élevées y perdront. Si l’on cumule la sous-indexation, la hausse des coûts de santé et la nouvelle fiscalité, les retraités apparaissent comme les grands perdants de ce budget.
Taxer les pauvres
Le gouvernement prévoit une « année blanche » pour les prestations sociales : malgré l’inflation, aucune revalorisation ne serait appliquée en 2026 pour les APL, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les allocations familiales ou les bourses étudiantes. Le budget propose également de reporter de 14 à 18 ans l’âge à partir duquel les allocations familiales sont majorées pour le deuxième enfant, une mesure qui pénaliserait directement les familles comptant des adolescents. Selon les estimations, cela représente une baisse de 900 à 2700 euros par an et par famille.
Sébastien Lecornu s’est aussi déclaré favorable à une proposition des Républicains qui veulent créer une « allocation sociale unique », qui regrouperait les principales prestations et serait plafonnée à 70 % du SMIC, soit moins de 1000 euros par mois – un montant inférieur au seuil de pauvreté (1288 euros).
Cerise sur le gâteau, le texte contient aussi une mesure proprement raciste : la suppression de l’APL pour les étudiants étrangers hors Union européenne, déjà exclus du système de bourses du CROUS et soumis à des frais d’inscription jusqu’à seize fois plus élevés que les Européens.
Rejeté en première lecture par les députés, le gel du barème de l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire sa non-indexation sur l’inflation) rendrait imposables 200 000 à 380 000 nouveaux foyers. Un salarié célibataire gagnant 1540 euros nets par mois deviendrait ainsi imposable, tandis que d’autres catégories verraient leur impôt augmenter. Le budget prévoit aussi la fin de l’exonération de cotisations sociales pour les apprentis, entraînant une baisse nette de leurs revenus de 101 à 188 euros par mois selon l’âge et le niveau d’études.
… et les malades !
Le budget de la Sécurité sociale présenté dans le PLFSS 2026 prévoit des économies importantes pour le secteur de la santé, estimées à environ 5 milliards d’euros. Le gouvernement souhaite notamment réduire les dépenses liées aux affections de longue durée (ALD) comme les cancers, le diabète, certaines maladies mentales ou d’autres pathologies chroniques.
Le texte inclut déjà le doublement des franchises médicales (le reste à charge sur chaque acte ou médicament prescrit), ce qui pourrait représenter jusqu’à 100 euros supplémentaires par an pour les patients, y compris ceux affligés d’une ALD. D’autres pistes d’économies ont été évoquées : la taxation des indemnités journalières versées à certains patients en ALD, ou encore la limitation des arrêts maladie à quinze jours maximum pour un premier arrêt.
Dans le même temps, l’Etat continuera de verser près de 270 milliards d’euros par an aux entreprises. D’ailleurs, avec ce budget, il continue de rogner la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), un impôt sur la production appelé à disparaître totalement d’ici 2028.
L’armée grande gagnante
Le seul ministère à bénéficier d’une hausse de son enveloppe est le ministère des Armées, qui va toucher 6,7 milliards d’euros en plus. L’objectif affiché : atteindre 66 milliards d’euros en 2030 – soit un doublement du budget militaire par rapport à 2017.
Pour tenter de convaincre l’opinion publique de la nécessité de ces investissements, les cadres de l’armée française sont sortis de leur traditionnel silence pour expliquer sur les plateaux télé pourquoi il faut « réarmer la France » face à la « menace russe ». Le chef d’état-major des armées a même été dépêché à l’Assemblée pour alerter sur un possible « choc dans les trois ou quatre ans » avec la Russie. Celui de l’armée de Terre a, de son côté, déclaré se tenir prêt à «déployer des forces au profit de l’Ukraine » dès 2026.
Toute la propagande sur les soi-disant projets d’invasions de l’Europe que nourrirait l’impérialisme russe est absurde. Cette agitation n’est qu’un moyen pour la bourgeoisie de rallier la population derrière elle, de justifier sa politique impérialiste et de faire accepter la hausse des budgets militaires. Cette dernière devrait se faire d’ailleurs sans recourir à l’endettement, ce qui revient à dire qu’elle sera financée par l’austérité. Chaque euro consacré à la « défense » sera donc pris sur la santé, l’éducation et les aides sociales.
Taxer les riches ?
Pour donner le change et offrir un semblant de « justice sociale », le gouvernement a annoncé qu’il taxerait les hauts patrimoines. Le budget prolonge la Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), instaurée l’an dernier. Cette mesure ne rapporte qu’à peine 2 milliards d’euros par an et ne change rien à l’inégalité fiscale : le taux global d’imposition des 1 % les plus riches resterait entre 20 et 30 %, contre environ 51 % pour la moyenne des Français.
Une nouvelle taxe sur les holdings sera créée, qui viserait les sociétés ne gérant que des placements financiers supérieurs à 5 millions d’euros d’actifs. Bercy espère en tirer 2,5 milliards d’euros, mais l’économiste Gabriel Zucman a souligné que cette mesure serait « parfaitement inefficace », car elle est « mitée d’exemptions » permettant aux plus riches d’y échapper. La manœuvre est claire : il s’agit pour le gouvernement, à l’heure où il exige des travailleurs qu’ils se serrent la ceinture, de prétendre que l’effort fiscal est « partagé » entre riches et pauvres.
Bloquons tout !
Dans un mail adressé à ses soutiens le 17 octobre, La France insoumise appelle à la « résistance populaire et parlementaire » face au budget. Mais, en réalité, LFI se focalise sur la soi-disant résistance « parlementaire », qui est parfaitement stérile. Ce n’est pas le parlement qui a fait tomber Bayrou, mais la menace de la mobilisation du 10 septembre. Tous les travailleurs et les jeunes les plus avancés en sont bien conscients. C’est pour cela qu’ils accordent peu d’intérêt à la pantomime des postures parlementaires et des petits calculs électoraux qui se déroule en ce moment à l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, comme nous l’avons déjà expliqué, cette somme d’intérêts contradictoires entre les différents groupes parlementaires de la bourgeoisie pourrait tout à fait faire s’effondrer le fragile échafaudage du gouvernement Lecornu en même temps que son budget. Mais cela ne signifierait pas forcément la fin des plans d’austérité dont la classe dirigeante française a objectivement besoin pour défendre ses profits.
Pour être sûr de repousser ce budget et tous les projets austéritaires de la bourgeoisie, il faut préparer une mobilisation de masse dans la rue et dans les entreprises. Mais celle-ci reste à construire. Ni LFI ni la CGT n’ont, pour l’instant, impulsé de véritable mobilisation d’ampleur. L’intersyndicale, au contraire, a sciemment saboté la mobilisation du 10 septembre et a salué la suspension de la réforme des retraites, qualifiée de « première avancée après de longs mois de mobilisation ».
Le 16 octobre, invitée des 4 Vérités sur France 2, Sophie Binet (CGT) n’a même pas appelé à une nouvelle journée d’action interprofessionnelle : elle a expliqué que l’intersyndicale mobiliserait en fonction du calendrier parlementaire. Elle s’est ensuite contentée d’appeler à rejoindre la journée de mobilisation des retraités du 9 novembre – qui ne devrait guère ébranler le gouvernement.
Alors que la voie parlementaire est bouchée, c’est sur le terrain social et extraparlementaire que se jouera la suite. Depuis cet été, le bon mot d’ordre s’est imposé depuis la base : « Bloquons tout ! »