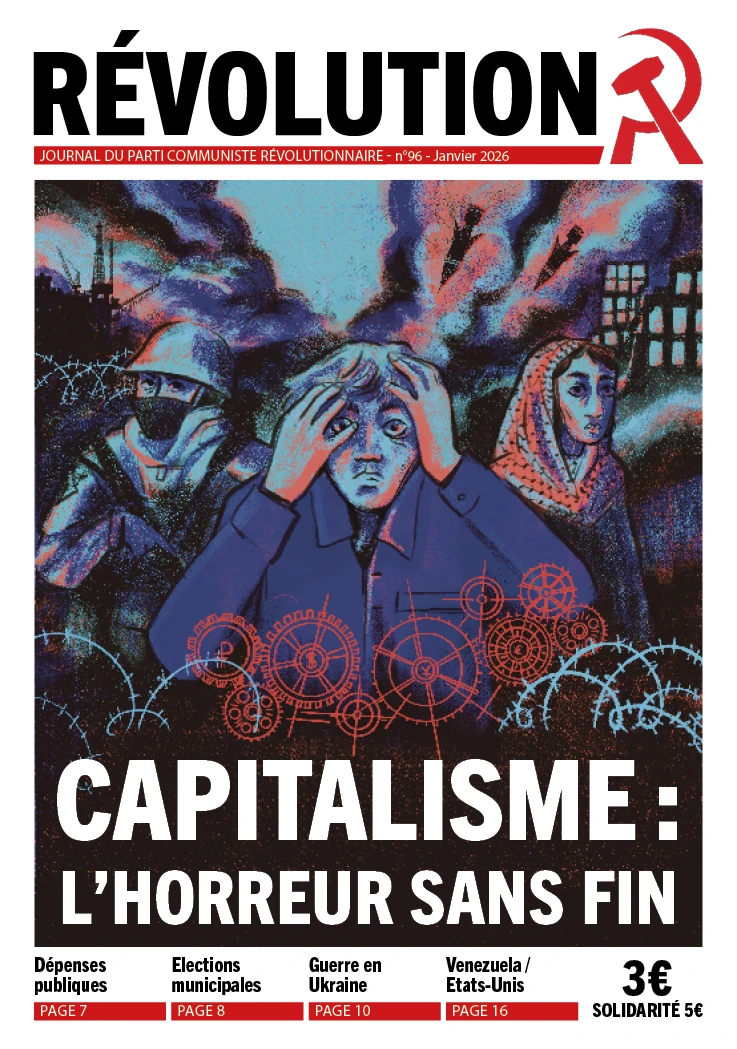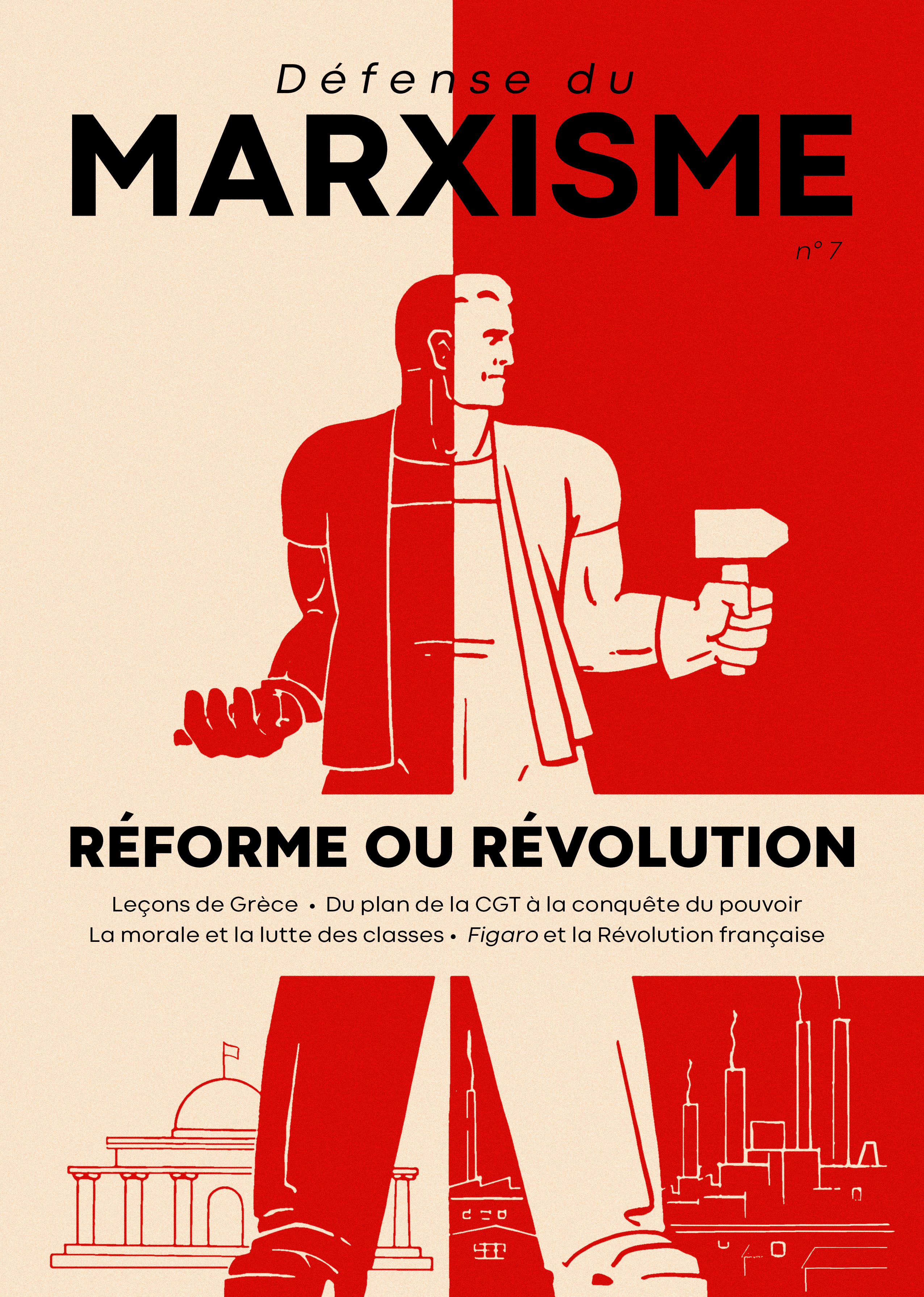Cet été, pendant trois semaines, des millions de spectateurs vont suivre le Tour de France, sur les routes ou devant leur écran. Les coureurs cyclistes vont lutter contre la chaleur et la pente avec une endurance hors du commun, sur plus de 3000 kilomètres. On estime que le Tour de France serait la troisième compétition sportive la plus suivie au monde, juste derrière la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. Mais la course n’est pas seulement le rendez-vous traditionnel du mois de juillet pour les fans de sport : aux yeux de la famille Amaury, propriétaire de l’épreuve depuis 1965, le Tour est avant tout un business.
Course au profit
Créé en 1903, le Tour a toujours été au cœur d’intérêts commerciaux. Le fondateur de la compétition, Henri Desgrange, également propriétaire du journal L’Auto, voyait l’événement comme un moyen d’augmenter les ventes de son journal. L’opération a réussi, notamment parce que le cyclisme était l’une des activités sportives les plus répandues en France au début du XXe siècle.
L’industrie de la presse n’est pas la seule à s’intéresser au Tour : très vite, les fabricants de vélos ont fourni les deux-roues aux coureurs pour en faire la promotion auprès des spectateurs, et les premiers sponsors apparaissent aussi sur les dossards des coureurs et aux abords de la course.
Pour accentuer le caractère spectaculaire de l’événement – et attirer encore davantage de spectateurs –, la compétition atteint pour la première fois les sommets des Pyrénées et des Alpes en 1910 et 1911. L’année 1930 voit la naissance de la « caravane du Tour », véritable défilé de véhicules publicitaires, permettant aux marques de distribuer des échantillons au public massé sur le bord des routes.
Les années 1960 sont marquées par la rivalité entre deux coureurs français au style bien différent : Anquetil et Poulidor. « Poupou », aussi surnommé « l’éternel second », formidable grimpeur, est le favori du public. Anquetil, par son professionnalisme et sa rigueur, incarne la professionnalisation croissante du cyclisme moderne, et devient le premier coureur à remporter cinq Tours de France.
Dopage
Le Tour de France prend une nouvelle dimension dans les années 1990. Les chaînes de télévision s’arrachent les droits de retransmission, ce qui augmente considérablement la visibilité de l’événement et provoque donc une forte hausse des revenus publicitaires. A ce jour, les droits de retransmission constituent 60 % des recettes générées par le Tour. Diffusée dans près de 190 pays, la course bénéficie alors d’une audience mondiale. Le chiffre d’affaires grimpe, passant de 5 à 50 millions d’euros entre les années 1980 et les années 1990.
C’est aussi l’époque où le dopage devient particulièrement flagrant, notamment avec « l’affaire Festina » en 1998 ou lorsqu’il est révélé en 2012 que le coureur américain Lance Armstrong s’est massivement dopé pour pouvoir remporter sept fois la compétition de 1999 à 2005. Mais la triche n’était pas un phénomène nouveau : lors des premières éditions du Tour, certains coureurs étaient accusés de prendre des raccourcis une fois la nuit tombée. Henri Desgrange lui-même en payait secrètement d’autres pour garantir le spectacle.
La tricherie n’a ensuite fait que se perfectionner lorsque le dopage est devenu quasiment généralisé. Anquetil disait même : « je me dope parce que tout le monde se dope ». Poulidor lui aussi a reconnu s’être dopé régulièrement.
Cette pratique est en réalité inhérente à une compétition dont la principale motivation est l’appât du gain. D’un côté, les organisateurs conçoivent des parcours toujours plus éprouvants pour favoriser le « spectacle » et ainsi assurer leurs recettes publicitaires. De l’autre, la concurrence entre coureurs est rude pour les premières places, synonymes de rémunérations considérables : aujourd’hui, le vainqueur de la compétition gagne 500 000 euros, celui d’une simple étape 11 000 euros. Ce ne sont donc pas les coureurs qu’il faut blâmer, mais le système qui les pousse à se doper, au détriment de leur santé.
Débarrassons-nous du sport business !
La famille Amaury reste très discrète sur ses bénéfices, mais elle fait partie des 300 familles les plus riches de France. Elle possède le journal L’Equipe et de nombreuses autres compétitions sportives, comme le Rallye Dakar ou la course Paris-Roubaix.
Le chiffre d’affaires du Tour oscille entre 150 et 200 millions d’euros, dont près de 30 millions de bénéfice net. Si ce dernier chiffre est aussi important, c’est que le groupe veille scrupuleusement à la « maîtrise des coûts », surtout quand il s’agit de rémunérer les travailleurs du Tour. Pourtant indispensables à l’événement, les manutentionnaires, chauffeurs, agents de sécurité, hôtes d’accueil et agents de nettoyage sont, pour leur grande majorité, des intérimaires extrêmement précaires.
Il est plus que jamais nécessaire de libérer le cyclisme des logiques du profit : les amateurs de vélo et les travailleurs du Tour en sont les premières victimes. Les événements sportifs devraient être mis au service de la pratique sportive du plus grand nombre, et non des intérêts privés des capitalistes.