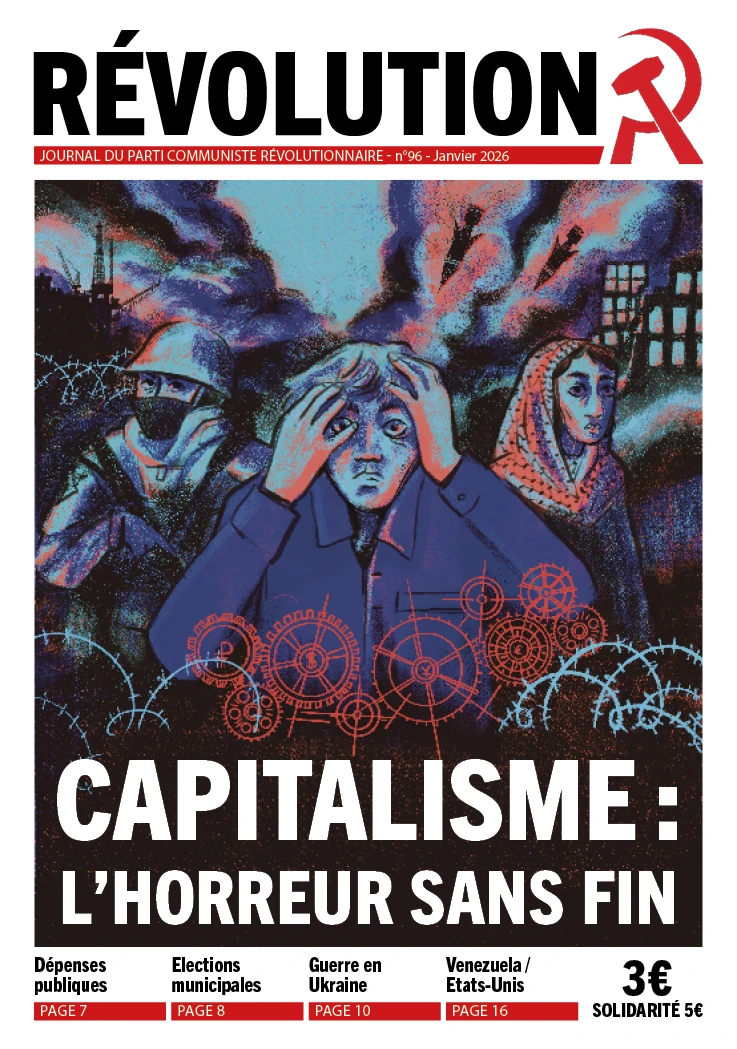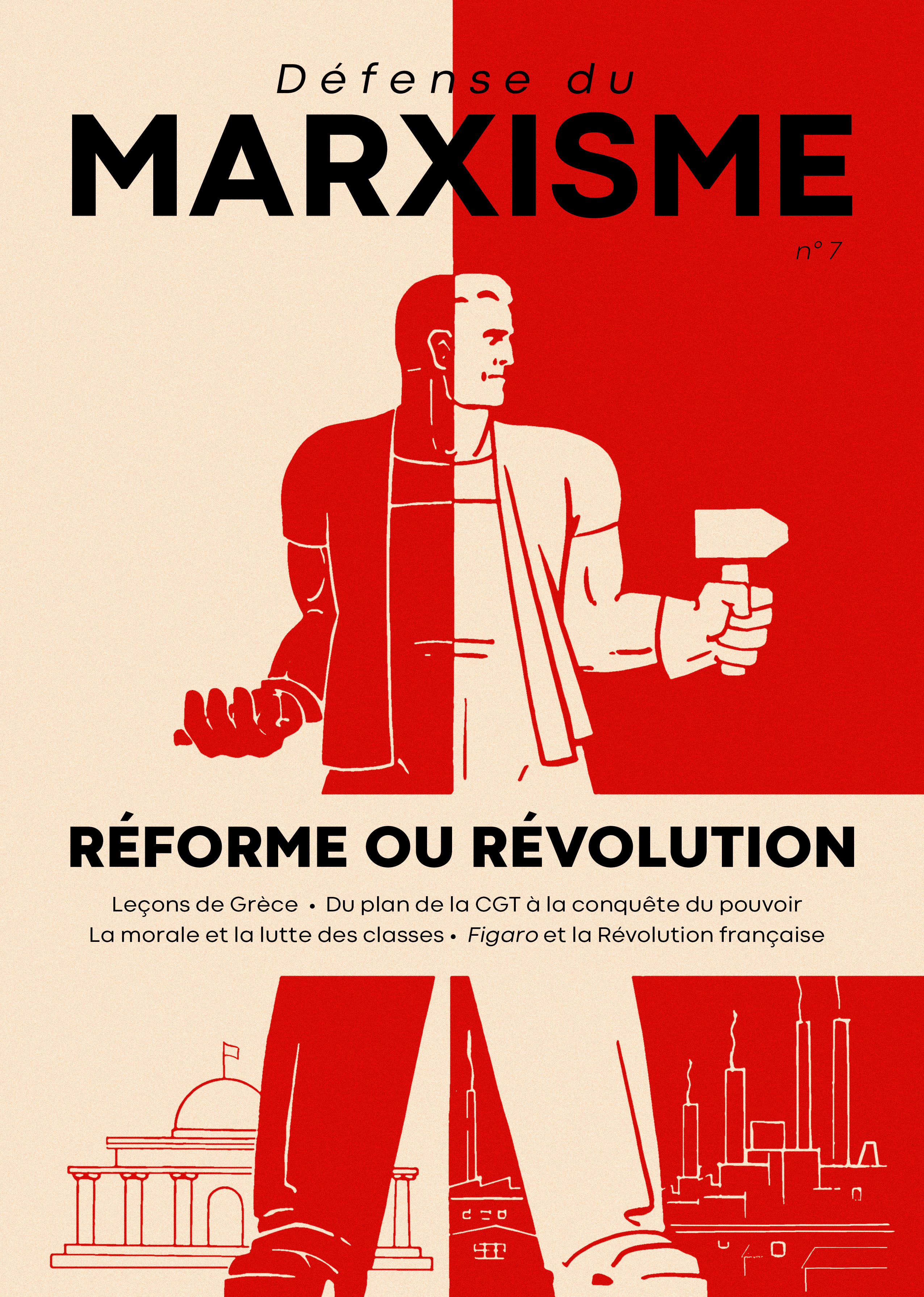En août, le gouvernement américain a déployé près de 4000 soldats au large du Venezuela, prétendument pour lutter contre les cartels de la drogue. Mais les unités engagées dans les Caraïbes ne sont pas spécialisées dans la lutte antidrogue. Parmi elles se trouve même un sous-marin nucléaire ! Difficile, dans ces conditions, de croire à une opération dirigée véritablement contre le trafic de stupéfiants.
Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a également affirmé que les Etats-Unis ne reconnaissaient pas le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro, qu’il accuse de « gérer et diriger » un cartel de la drogue. En réalité, c’est l’impérialisme américain qui, depuis plus d’un demi-siècle, s’appuie en Amérique latine sur des organisations paramilitaires d’extrême droite et des cartels, les arme et les finance pour réprimer les mobilisations des ouvriers, des paysans et des étudiants.
Lutte contre le narcotrafic ?
En septembre et en octobre, les Etats-Unis ont mené plusieurs frappes meurtrières – qui ont fait au moins 27 morts – contre des embarcations que l’administration américaine affirme liées au trafic de drogue en provenance du Venezuela, sans en apporter la moindre preuve sérieuse. En réalité, Trump utilise le prétexte de la lutte contre le narcotrafic pour justifier ses manœuvres impérialistes en Amérique latine, une région que les Etats-Unis ont toujours considérée comme leur chasse gardée. Il ajoute à la pression économique – notamment des droits de douane exorbitants – une pression militaire croissante sur les gouvernements de la région, afin de les contraindre à rompre leurs liens croissants avec la Chine.
Le 30 septembre 2025, le ministère de la Guerre a convoqué une réunion de 800 généraux, amiraux et commandants de l’armée de l’air à Quantico, en Virginie. Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Guerre, et Donald Trump y ont pris la parole. L’objectif de cette réunion n’a jamais été clairement expliqué, et les discours publiés ensuite n’ont apporté aucun éclaircissement. D’autres discours, dont le contenu n’a pas été rendu public, y ont été prononcés. Quel peut bien être l’objectif d’une telle réunion, sinon de préparer les sommets de l’armée à la guerre ? Deux cibles semblent actuellement être dans le viseur de Washington : l’Iran et le Venezuela.
Négociations infructueuses
Le New York Times écrivait récemment : « […] selon des responsables américains, le président Trump a interrompu les efforts visant à parvenir à un accord diplomatique avec le Venezuela, ouvrant ainsi la voie à une possible escalade militaire contre les trafiquants de drogue ou le gouvernement de Nicolas Maduro. »
À première vue, la posture agressive de Trump pouvait sembler contredite par l’envoi de son émissaire, Ric Grenell, qui était chargé de négocier un accord avec Maduro. De manière générale, Trump préfère les solutions négociées ; non par pacifisme, mais parce qu’une guerre coûte cher – beaucoup plus qu’un bon « deal ».
L’objectif de ces négociations était d’obtenir un compromis qui aurait préservé l’accès des entreprises américaines au pétrole vénézuélien. De son côté, Maduro cherchait désespérément un terrain d’entente : il a même adressé une lettre à Trump affirmant que son pays ne trafiquait pas de drogue et proposant de poursuivre les discussions.
Mais, sous la pression de Marco Rubio et de ses alliés néoconservateurs, Trump a finalement ordonné à Grenell de mettre fin à ces discussions début octobre. Peu après, le président a déclaré au Congrès que les Etats-Unis étaient engagés dans un « conflit armé » avec les cartels de la drogue. La diplomatie étant désormais écartée, la voie semble ouverte à une escalade militaire.
Les véritables objectifs de guerre de Washington
À ce jour, Washington n’a fourni aucune preuve solide de l’implication du gouvernement vénézuélien dans le trafic de drogue. Cela n’empêche pas la Maison-Blanche et ses relais de répéter cette accusation sur tous les tons. Cette campagne de propagande vise surtout à préparer l’opinion publique et à justifier une intervention militaire.
Un haut responsable américain déclarait récemment : « Le président est prêt à utiliser tous les éléments de la puissance américaine pour chasser Maduro du pouvoir. » Autrement dit, l’objectif est clair : il s’agit de provoquer un changement de régime pour installer un gouvernement pro-américain à Caracas, quels que soient les moyens nécessaires.
Cette logique n’est sans doute pas étrangère à la décision d’attribuer le prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado, cheffe de l’opposition vénézuélienne de droite, qui s’est empressée de dédier son prix à… Donald Trump ! Ce n’est pas la première fois que cette distinction est remise à un va-t-en-guerre impérialiste. Elle a été remise à Henry Kissinger l’année même où il organisa le coup d’Etat de Pinochet au Chili, ou à Barack Obama alors que celui-ci envoyait davantage de troupes américaines en Afghanistan, pour ne citer que ces deux exemples. Il n’empêche que c’est sans doute la première fois qu’elle revient à une personne qui appelle ouvertement à l’invasion de son propre pays !
Changement de régime ?
La rhétorique de Trump ne se limite plus à accuser Maduro de narcotrafic : il affirme aujourd’hui que son élection était illégitime. On pourrait penser que Trump cherche simplement à forcer Maduro à faire des concessions, mais ce dernier était prêt à céder sur tout dès le départ – le pétrole, les expulsions de migrants, etc. Affaibli, Maduro multiplie les compromis sans pour autant apaiser Washington. Or la faiblesse invite à l’agression.
Une invasion terrestre serait très risquée, d’autant que les forces américaines envoyées dans les Caraïbes sont clairement insuffisantes pour une telle opération. Cependant, l’armée américaine pourrait mener des attaques aériennes ciblées contre des figures du régime, dans l’espoir de provoquer un coup d’Etat militaire qui renverserait Maduro.
A ce stade, il est difficile de dire si les Etats-Unis parviendront à leurs fins. Cela dépend avant tout des masses vénézuéliennes qui, par le passé, ont constitué un rempart solide contre la réaction et l’impérialisme. Face aux menaces américaines, le gouvernement a décrété l’état d’urgence et mobilisé des réservistes. Mais le soutien dont bénéficie Maduro est tellement diminué qu’il ne s’est maintenu au pouvoir ces dernières années qu’en falsifiant les résultats électoraux.
Nicolas Maduro a depuis longtemps renoncé au programme de réformes sociales radicales d’Hugo Chavez. Ces dernières années, les riches sont devenus plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Bien qu’il se réclame encore de Chavez et de la révolution bolivarienne, le gouvernement de Maduro est devenu un régime bonapartiste bourgeois, qui joue l’arbitre entre les classes, vire de plus en plus à droite et attaque les acquis de la révolution, les droits des ouvriers et des paysans.
De même, la fidélité de l’appareil d’Etat – et en particulier celle des généraux de l’armée – à un régime bonapartiste ne peut être garantie, même si Maduro leur assure une existence privilégiée. Après tout, les empereurs romains dont le pouvoir dépendait de leur garde prétorienne finissaient souvent empalés sur les lances de ces mêmes gardiens. Dans les années 1970 au Chili, Salvador Allende, qui comptait sur le soutien de généraux « démocrates » tels que Pinochet, a connu le même sort. Une prime de 50 millions de dollars a d’ailleurs été mise sur la tête de Maduro par Donald Trump – une offre tentante pour les cadres de l’armée vénézuélienne.
L’avenir du Venezuela dépend aussi des divisions internes à Washington. Trump, soumis à de multiples pressions contradictoires, oscille entre négociations et escalade militaire. Au Pentagone, certains juristes se sont même interrogés sur la légalité des frappes meurtrières contre des trafiquants présumés. Un avis secret du ministère de la Justice a dû être produit pour justifier ces frappes.
Enfin, Trump doit aussi compter avec l’opinion publique américaine. Après plusieurs décennies de guerres meurtrières en Somalie, en Irak, en Afghanistan, etc., la majorité de la classe ouvrière et de la jeunesse des Etats-Unis est hostile à de nouvelles aventures militaires à l’étranger. L’une des promesses de campagne de Trump était d’ailleurs de mettre fin à ces guerres éternelles. Si le président américain déclarait un conflit armé avec le Venezuela, sa popularité, déjà entamée, risquerait de chuter encore davantage.
Notre attitude
Quelle doit être l’attitude des communistes révolutionnaires face aux manœuvres de Trump et à la menace d’une invasion américaine du Venezuela ?
Nous n’avons aucune confiance dans Maduro, sa politique ou son gouvernement, qui est dévoué aux intérêts des riches et des multinationales. Mais le renversement de ce régime par les gangsters impérialistes de Washington et leurs alliés locaux, qui dissimulent leurs intentions contre-révolutionnaires sous le masque hypocrite de la « restauration de la démocratie », serait totalement réactionnaire et ne produirait absolument rien de positif pour les travailleurs et les pauvres du Venezuela.
Les véritables objectifs de l’administration américaine sont parfaitement clairs. La perspective d’une reprise de la guerre contre l’Iran – toujours d’actualité – fait planer le spectre d’une crise de la production pétrolière et des échanges commerciaux au Moyen-Orient, susceptible d’entraîner une forte hausse des prix de l’énergie. Dans ce contexte, s’emparer des vastes réserves pétrolières du Venezuela est un élément central des calculs de Trump.
L’agression américaine obéit à une autre motivation, plus profonde : l’impérialisme américain craint de perdre le contrôle de l’Amérique latine face à l’expansion rapide de l’influence chinoise. Washington veut affirmer sa puissance économique et militaire pour freiner l’avancée de la Chine. Son objectif est d’intimider les gouvernements latino-américains, de les contraindre à rompre leurs liens avec Pékin et à se soumettre aux diktats de Washington.
Nous devons donc nous opposer par tous les moyens aux manœuvres impérialistes des Etats-Unis dans les Caraïbes. Dans sa lutte contre l’impérialisme, la classe ouvrière du Venezuela devra en appeler à la solidarité internationaliste des travailleurs de la région, qui sont eux aussi soumis à la menace de l’exportation de la « démocratie » américaine, ainsi que celle des travailleurs et de la jeunesse des Etats-Unis, qui sont hostiles aux aventures impérialistes.
Comme l’expliquent nos camarades du Venezuela et des Etats-Unis, seule la révolution socialiste étendue à l’échelle du continent permettra d’en finir avec l’impérialisme américain !