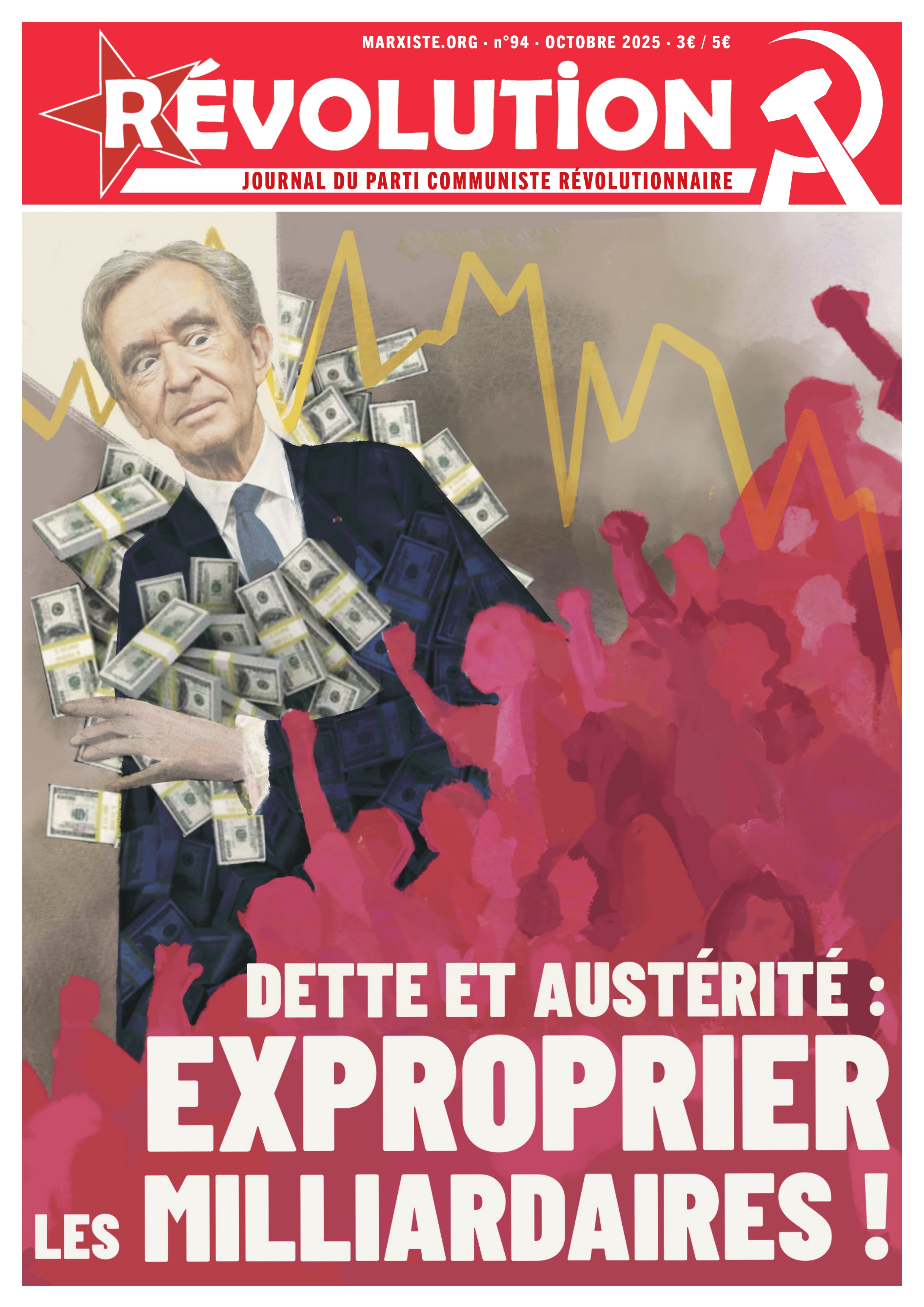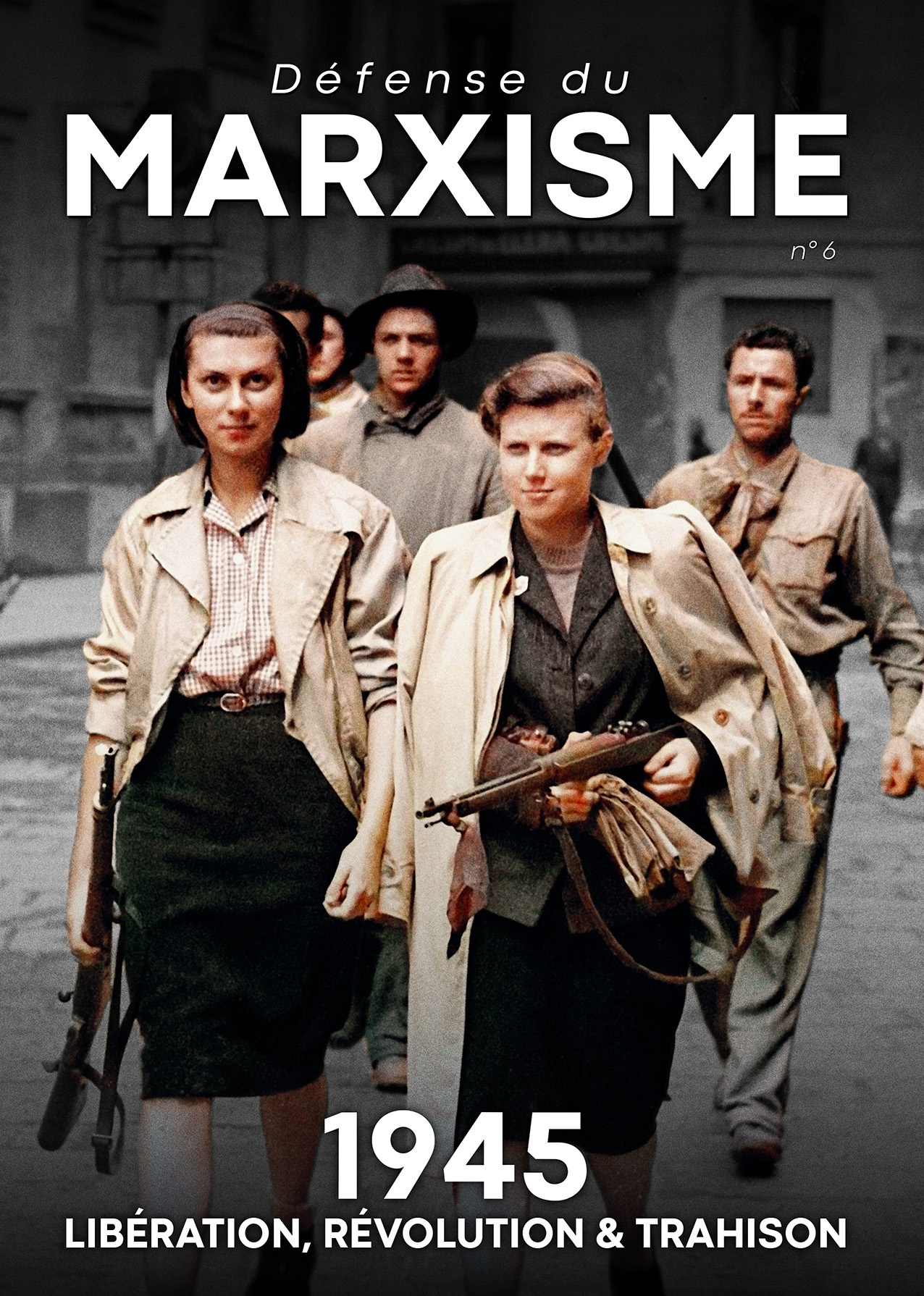Après quinze ans de travail, j’ai été contrainte de repenser mon avenir professionnel. Attirée par le travail manuel, le concret, le soin du détail, je me suis tournée vers la peinture en bâtiment. Ce choix représentait la promesse d’apprendre un vrai métier, utile et reconnu comme tel.
Mais cette reconversion s’est vite révélée un parcours d’obstacles. Entre une formation au rabais et des conditions de travail indignes, mon expérience a pris fin brutalement, à la suite d’un accident du travail. En moins d’un an, tout un projet de vie s’est effondré. Ce récit n’est pas seulement celui d’un échec personnel : il est le reflet d’un système qui broie les travailleurs au nom du profit.
La face cachée des centres de formation
Trouver une formation convenable dans le bâtiment est difficile. France Travail ne contrôle pas réellement le sérieux des organismes, ce qui laisse les demandeurs exposés aux arnaques. Les centres agréés par le Compte Personnel de Formation (CPF) existent, mais leurs formations sont souvent très chères.
Pour des personnes ayant déjà connu des carrières instables ou rencontrant des difficultés à accéder à l’emploi, il faut souvent payer une partie de la formation de sa poche. Dans mon cas, seuls deux centres sur tous ceux que j’ai contactés proposaient des formations gratuites, avec un nombre de places très limité. Pour les autres, il fallait compléter mon compte formation d’environ 2 000 € ! C’est considérable.
La Caisse des dépôts, qui gère le CPF, affirme que cette année, seulement 1,29 % des écoles seront vérifiées. Les contrôles se font surtout au moment où le centre obtient sa certification, mais une fois celle-ci acquise, il est très rare qu’un centre soit de nouveau inspecté. L’Etat ne garantit pas de moyens suffisants aux organismes chargés de ces contrôles, qui portent surtout sur l’organisation administrative et très peu sur la qualité pédagogique.
Or, c’est bien la pédagogie qui devrait être au cœur des vérifications. L’Etat a mis en place la certification Qualiopi, censée résoudre ce problème. Mais les critères sont si vagues que, dans les faits, 99,3 % des centres qui en font la demande l’obtiennent. Pourtant, les étudiants signalent régulièrement que les formations sont incomplètes ou superficielles. Dans mon cas, les cours se résumaient à des fiches techniques fournies par des marques de peinture. Ils ne donnaient aucune connaissance réelle sur les produits utilisés ni sur leurs dangers.
Les comportements de certains formateurs posaient aussi problème. Plusieurs se montraient méprisants envers ceux qui posaient des questions ou envers les élèves plus fragiles, notamment ceux dont le vocabulaire était limité ou la maîtrise du français faible. Un formateur m’a même confié que les maltraitances verbales, physiques ou sexuelles étaient fréquentes dans les centres de formation du BTP, surtout envers un public précaire, et que ces incidents étaient souvent passés sous silence par la direction. Durant ma formation, un professeur a d’ailleurs été licencié pour s’être introduit dans le vestiaire des femmes : cette fois, la direction n’avait pas pu faire l’autruche.
Les examens ne garantissaient pas non plus une évaluation réelle des compétences. Dès le début, on m’a précisé que les jurys étaient bénévoles, et que certaines compensations proposées par le centre pouvaient influencer la validation de la formation.
Mon centre privilégiait les formations courtes et non diplômantes (POEI), souvent destinées à des publics précaires. Dans ma promotion, seuls deux participants sur trente avaient réellement choisi la formation ; les autres y étaient envoyés par contrainte, par France Travail ou des agences d’intérim. Pour le centre, cela assurait une rentrée d’argent régulière ; pour les agences d’intérim, cela permettait de fournir aux entreprises des travailleurs « formés » mais sous-payés, puisque non diplômés.
Enfin, certaines formations mélangeaient plusieurs métiers (peintre, solier, façadier). Des collègues m’ont expliqué que ces compétences « supplémentaires » ne sont jamais reconnues dans les salaires : elles servent simplement à exiger davantage de travail.
Maladies et accidents professionnels
Sur de nombreux chantiers, le travail en coactivité est devenu la règle. Tous les corps de métier interviennent en même temps, sans réelle coordination. Cette organisation provoque des conflits entre équipes, multiplie les malfaçons et entraîne des retards.
J’ai par exemple travaillé à côté d’un ouvrier qui découpait un mur déjà peint pour installer un balcon. Ce type de situation illustre le manque de planification et les pertes de temps que cela engendre. Ces pratiques ne sont pas seulement inefficaces : elles sont dangereuses. J’ai moi-même exposé à des produits toxiques d’autres artisans qui travaillaient dans la même pièce que moi ; eux n’avaient pas de masques.
Les délais, souvent irréalistes, ajoutent une pression constante. J’ai déjà été bloquée sur un chantier parce que la pièce que je devais peindre était encombrée par les affaires d’autres ouvriers. Cela retarde tout le monde : autant moi, qui ne pouvais pas travailler, que ceux qui devaient déplacer leur matériel. Pour avancer coûte que coûte, les règles de sécurité sont négligées, ce qui augmente les risques.
Les accidents sont fréquents, mais rarement reconnus. Mon propre accident en est un exemple. Je partageais le chantier avec une équipe de déménageurs, chacun pris par des délais impossibles à tenir. Un déménageur, chargé d’un objet lourd, ne m’a pas vue et nous sommes entrés en collision pendant que je peignais. Ignorant les démarches à suivre, ne voulant pas pénaliser mes collègues et jugeant la douleur supportable, j’ai repris le travail dès le lendemain. Mon rendez-vous chez le médecin n’a eu lieu qu’une semaine plus tard, rendant impossible la déclaration de l’accident dans le délai légal de 24 heures. En parlant avec d’autres collègues, j’ai compris que tous avaient vécu des situations similaires, presque banalisées sur les chantiers.
Plus généralement, les problèmes de dos et de genoux sont fréquents. Les maladies respiratoires se multiplient à cause des poussières et des produits chimiques. À tout cela s’ajoutent désormais les effets du changement climatique : les canicules, de plus en plus fréquentes, aggravent encore les conditions de travail. Travailler sans pause au-delà des températures autorisées, sans avoir toujours accès à de l’eau, expose les ouvriers à la déshydratation, aux malaises et aux coups de chaleur.
Les soi-disant « mesures d’adaptation » ne sont presque jamais appliquées. L’eau n’est pas fournie, ou alors on n’a pas le temps de s’arrêter pour boire. Sous la chaleur, les produits sèchent trop vite, et interrompre le travail ne serait-ce que quelques secondes peut compromettre le résultat. Le ponçage, lui, se faisait toujours fenêtres ouvertes, laissait rentrer la chaleur pendant les canicules, avec une machine de deux kilos à bout de bras. Travailler à l’intérieur, dans des pièces étouffantes où la peinture et l’enduit saturent l’air d’humidité, devient vite insupportable. Pourtant, les horaires restent inchangés, même en période de canicule.
Entre 2018 et 2023, selon Le Monde, 48 travailleurs seraient morts dans des accidents du travail liés à la chaleur – un chiffre largement sous-estimé selon Santé Publique France. D’ailleurs, le bâtiment et les travaux publics représentent à eux seuls un quart des accidents mortels du travail.
Quant au droit de retrait, il reste complètement illusoire. Sur le papier, il est dit qu’on peut l’utiliser en cas de danger ; mais dans la réalité, surtout quand on est précaire (8 % d’intérimaires dans le BTP), cela revient simplement à perdre sa mission. Personne n’ose s’arrêter, même quand les conditions deviennent intenables. On se tait, on continue, parce qu’on sait très bien qu’on sera remplacé dès le lendemain si on proteste.
Sous-traitance et exploitation
Le secteur du BTP repose largement sur la sous-traitance en cascade. Ce système, souvent opaque, emploie de nombreux travailleurs étrangers. Beaucoup ne parlent pas français, sont isolés et donc particulièrement vulnérables. Faute de traducteurs, ils peinent à défendre leurs droits.
L’Etat réduit constamment les moyens de l’inspection du travail, ce qui favorise les abus. Le travail les week-ends et jours fériés est courant. Les heures supplémentaires dépassent souvent le cadre légal et ne sont pas toujours payées. Sur un de mes chantiers, mes collègues travaillaient du lundi au dimanche sans pause. Les fiches de paie comportaient régulièrement des erreurs qu’il fallait sans cesse contester. À la fin de mon contrat, il m’a même fallu menacer l’entreprise de saisir un avocat pour obtenir ma dernière fiche de paie.
Côté salariés, tous ces problèmes ont pour conséquence des salaires en retard, des primes non versées, des journées ou trajets non rémunérés. À cela s’ajoutent le harcèlement et les pressions pour accepter du travail gratuit ou sous-payé. L’entreprise pour laquelle je travaillais n’avait perçu que le premier versement d’un chantier prévu pour durer plus d’un an. Pour compenser ce manque de trésorerie, elle a choisi de faire des économies sur le dos des salariés. Les salaires arrivaient souvent en retard, parfois incomplets, et les cadences imposées étaient tout simplement intenables. Le chef acceptait tous les chantiers possibles, sans se soucier des conditions ni des distances. Certains se trouvaient à plus de deux heures de route, mais nous devions tout de même nous y rendre, sans toujours être rémunérés au prix juste pour le trajet. Cette gestion fondée sur l’urgence et l’économie de moyens épuisait les équipes et dégradait inévitablement la qualité du travail accompli.
Nous avons besoin de formations publiques, gratuites et de qualité, qui donnent aux travailleurs de vraies compétences et une véritable protection. Le BTP ne doit pas être un secteur où l’on use et jette les travailleurs comme du matériel. C’est un secteur vital, qui construit nos logements, nos écoles, nos hôpitaux. Les grandes entreprises du BTP et leurs principaux sous-traitants devraient être nationalisés et gérés démocratiquement par les travailleurs. C'est la seule façon de défendre réellement les conditions de travail des salariés du BTP, tout en ouvrant la possibilité de planifier de grands travaux publics qui serviront les intérêts de toute la société.