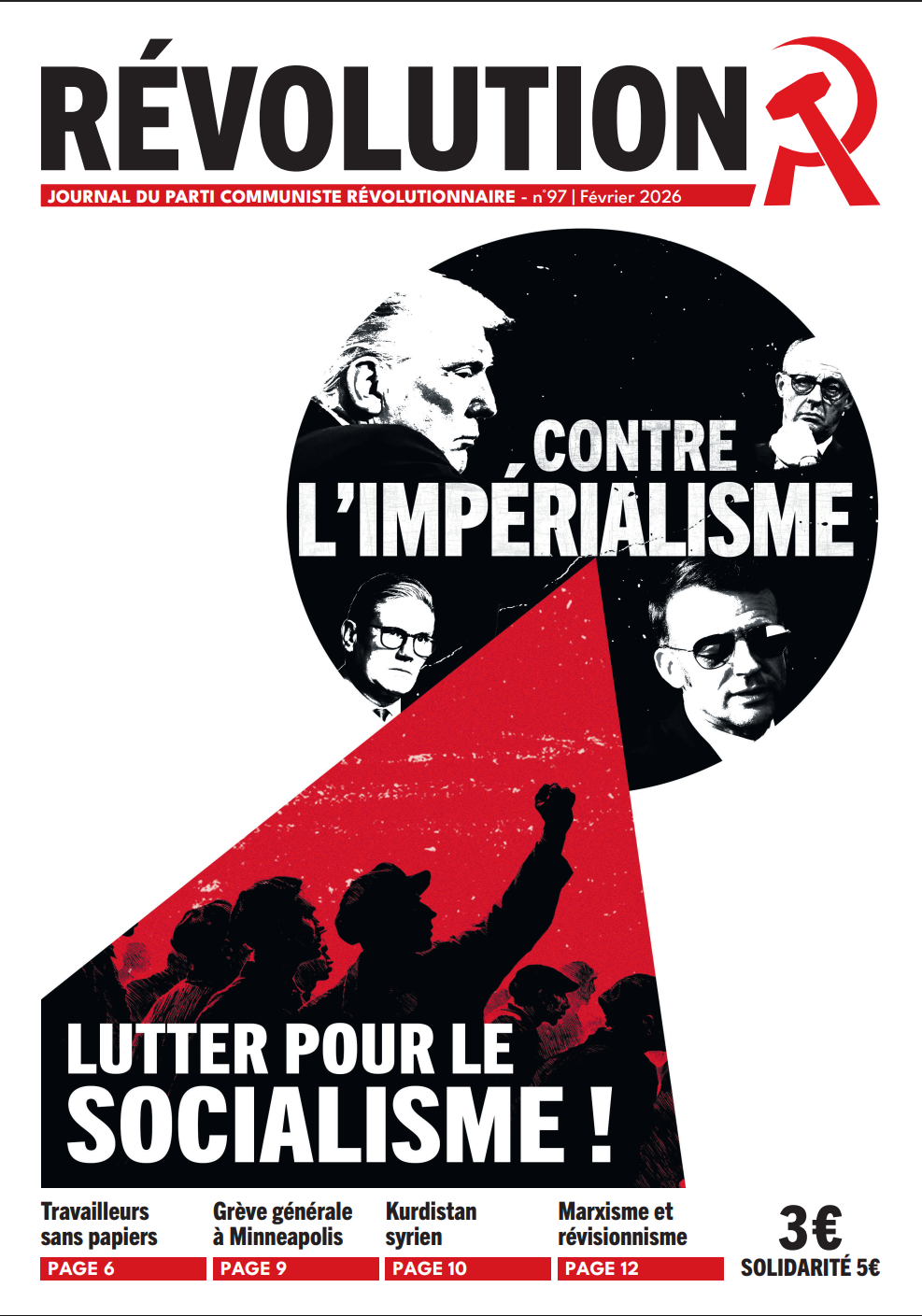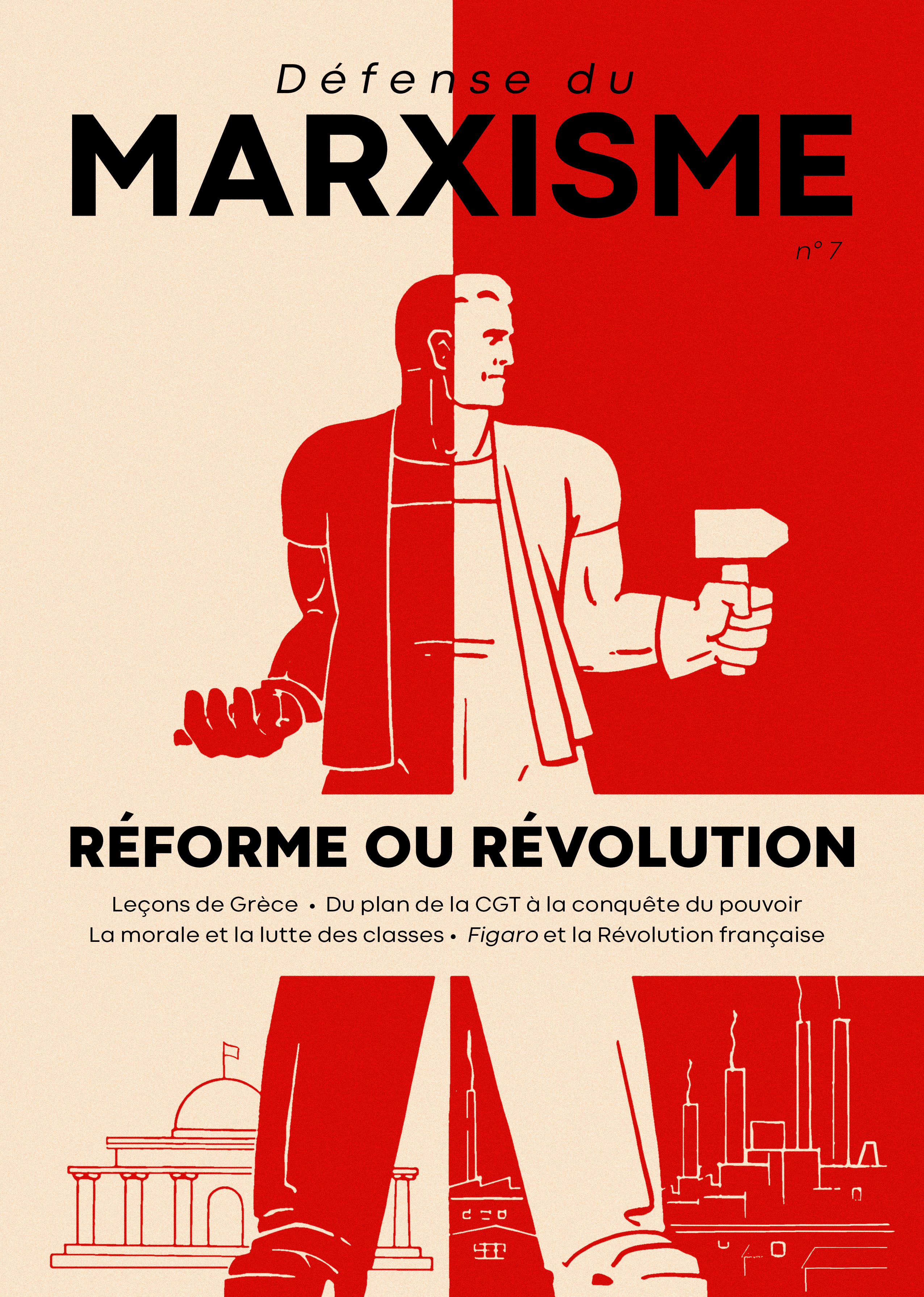L’éclatement de la Première Guerre mondiale a provoqué l’effondrement de la Deuxième internationale, et sa conclusion a déclenché une vague de révolutions. C’est dans ce contexte que Lénine a réussi à bâtir la Troisième Internationale (Communiste), qui disposait de puissantes sections dans de nombreux pays et qui se donnait pour objectif d’être la direction nécessaire à la victoire de la révolution mondiale. Dans cet article, Fred Weston explique comment fut créée cette nouvelle internationale, et le rôle que jouèrent Lénine et Trotsky dans l’éducation d’une nouvelle couche de communistes, pour les préparer aux tâches qui les attendaient.
Puisque le capitalisme est un système mondial, la lutte pour le renverser doit donc l’être elle aussi. C’est pour cela que, depuis l’époque de Marx et Engels, les marxistes (c’est-à-dire les communistes révolutionnaires) se sont toujours organisés à l’échelle internationale : dans la Première, puis la Deuxième, la Troisième, et enfin la Quatrième Internationale.
Aujourd’hui, le système capitaliste est à nouveau plongé dans une profonde crise mondiale. Où que nous tournions nos regards, il y a des guerres et des guerres civiles, des famines, des catastrophes produites par le changement climatique, la hausse du coût de la vie, des niveaux d’endettements inouïs, et une succession de crises politiques dans un pays après l’autre, avec de brusques oscillations vers la gauche et vers la droite.
Cela provoque des éruptions de colère révolutionnaire des masses aux quatre coins de la planète – comme au Sri Lanka l’an dernier, au Kenya et au Bangladesh cette année. Le monde se dirige tout droit vers une révolution sociale généralisée.
La situation exige donc, comme du temps de Lénine, une organisation internationale qui rassemble les communistes révolutionnaires de tous les pays. C’est pour cette raison que nous avons créé l’Internationale Communiste Révolutionnaire (ICR). Elle doit être un phare pour tous les travailleurs et jeunes sérieux qui ont compris qu’une révolution est nécessaire.
Notre objectif est de bâtir une internationale révolutionnaire de masse, qui puisse fournir la direction dont la prochaine vague révolutionnaire aura besoin pour en finir avec le système capitaliste et ne pas s’achever par une défaite de la classe ouvrière, comme ce fut le cas par le passé.
L’expérience historique des premières années de la Troisième Internationale (l’Internationale Communiste, ou « Komintern ») est précieuse pour nous qui construisons aujourd’hui les sections de l’ICR. Comment les forces relativement faibles dont nous disposons peuvent-elles être transformées en puissants Partis Communistes Révolutionnaires de masse ?
La nécessité d’une nouvelle internationale
L’éclatement de la Première Guerre mondiale en juillet 1914 fut un tournant décisif dans l’histoire mondiale. Pour satisfaire leurs ambitions prédatrices, les puissances impérialistes d’Europe ont envoyé leurs classes ouvrières respectives s’entre-tuer. Il fallait alors, plus que jamais, une direction clairement internationaliste, pour dissiper les brumes de la fièvre guerrière et transformer la guerre impérialiste en une guerre de classe. Mais presque tous les dirigeants des partis de la Deuxième Internationale avaient capitulé et soutenaient « leurs » propres capitalistes.
Cette trahison trouvait son origine dans le fait que la Deuxième Internationale, fondée en 1889, s’était développée durant une phase de croissance du capitalisme. Le fait que la classe ouvrière était parvenue, à travers la lutte des classes, à obtenir des réformes avait eu un impact sur ses dirigeants. Ceux-ci en tirèrent la conclusion qu’il suffirait d’une succession de réformes graduelles pour parvenir au socialisme et remplacèrent progressivement le programme de la révolution socialiste par le réformisme et la collaboration de classe.
Ces tendances opportunistes furent la cible de nombreuses polémiques, mais l’ampleur que prit cette dégénérescence resta largement indiscernable. Dans leur pratique quotidienne, nombre de dirigeants locaux commençaient de facto à appliquer une politique de collaboration de classe. Mais la position officielle du Parti social-démocrate allemand (SPD) ne changeait pas et restait fidèle au marxisme. C’est pourquoi, au début de la guerre, Lénine fut si choqué d’apprendre la capitulation des dirigeants du SPD qu’il crut d’abord que le numéro de leur journal qui annonçait leur ralliement à la guerre était un faux, fabriqué par l’Etat-major allemand.
Dès que Lénine prit conscience de l’ampleur de la trahison, il émit néanmoins un jugement correct : la Deuxième Internationale était incapable d’assurer la victoire de la révolution socialiste mondiale. Il proclama donc dès novembre 1914 qu’il était nécessaire de bâtir une troisième internationale.
Mais dans les circonstances de la guerre impérialiste, alors que les organisations ouvrières se vidaient de leurs adhérents et que les dirigeants « socialistes » trahissaient, les conditions pour fonder une telle internationale n’étaient pas encore réunies. En 1915, lors de la conférence de Zimmerwald contre la guerre, Lénine remarqua que tous les véritables internationalistes de la planète pouvaient tenir dans quelques voitures. Il fallut que se produisent de nouveaux événements – à commencer par la révolution russe de 1917 – pour faire émerger les forces d’une nouvelle internationale.
L’importance de la théorie
La tâche la plus importante accomplie par Lénine pour refonder une internationale révolutionnaire fut de sauver la méthode et le programme du marxisme authentique, que les opportunistes avaient avilis.
Ce n’est pas un hasard si, en 1914 après l’éclatement de la Première Guerre mondiale, Lénine prit le temps d’étudier attentivement Hegel. Il savait en effet qu’on ne peut pleinement saisir la méthode de Marx sans comprendre la dialectique de Hegel.
Lénine appliqua cette méthode avec brio dans sa lutte contre les soi-disant « marxistes » qui citaient des bribes de Marx pour justifier le soutien à « leurs » classes dirigeantes durant la guerre. Les écrits de Lénine dans cette période représentent une véritable mine d’or de théorie marxiste : La faillite de la Deuxième Internationale (1915), la brochure Le socialisme et la guerre (1915), ou encore le célèbre Impérialisme, stade suprême du capitalisme (qui fut écrit entre janvier et juin 1916).
L’œuvre clarificatrice de Lénine et sa défense du marxisme furent décisives : elles permirent aux bolcheviks de mener la Révolution russe à la victoire. Ses Lettres de loin (écrites en mars 1917), suivies des Thèses d’avril, et son ouvrage clé sur L’Etat et la révolution (écrit en août-septembre 1917) jouèrent un rôle essentiel dans le combat contre les vacillations des dirigeants bolcheviks durant la révolution.
L’histoire du Parti bolchevik est riche en leçons sur la construction du parti révolutionnaire. Il passa par des périodes de clandestinité, avec de petites cellules opérant dans des conditions extrêmement difficiles, mais aussi par des phases de travail de masse, comme lors de la première Révolution russe en 1905.
L’expérience du Parti bolchevik constitua le fondement théorique de l’Internationale communiste à l’époque de ses quatre premiers congrès (1919-1922) et est nettement perceptible dans les débats.
L’étude des résolutions, documents et discours de ces quatre premiers congrès révèle le rôle pédagogique fondamental que jouèrent Lénine et Trotsky, deux géants du marxisme. Ils comprenaient qu’ils devaient transmettre l’expérience et les idées qu’ils avaient accumulées à une nouvelle génération de dirigeants communistes. Ils espéraient ainsi armer les jeunes partis communistes qui se développaient à travers le monde avec les méthodes et les tactiques qui seraient nécessaires à la victoire.
Le premier congrès : un appel aux armes
Les grands événements créent les conditions nécessaires aux révolutions et sont eux-mêmes préparés par la crise du capitalisme. La Révolution russe de 1917 fut la première d’une vague de révolutions qui balaya l’Europe, juste après la Première Guerre mondiale. Les conditions objectives de la révolution avaient mûri ou mûrissaient dans un pays après l’autre.
En janvier 1918, l’Autriche-Hongrie fut secouée par une grève générale aux proportions révolutionnaires. En novembre de la même année, la Révolution allemande balaya le kaiser et mit fin à la guerre. Les dirigeants du SPD furent propulsés au gouvernement – et firent tout leur possible pour rendre le pouvoir aux capitalistes. La révolution revint ensuite en Autriche, où les sociaux-démocrates autrichiens trahirent à leur tour les travailleurs.
Entre-temps, la Deuxième internationale s’était divisée grosso modo en trois camps. D’abord, les chauvins déclarés, qui avaient ouvertement trahi pendant la guerre. Puis ceux que Lénine appelait le « Centre » – et dont Karl Kautsky était le porte-étendard – qui utilisaient une phraséologie révolutionnaire pour dissimuler leur opportunisme. Enfin, une aile révolutionnaire, de plus en plus grande, dont beaucoup de membres avaient quitté la Deuxième internationale et fondé des partis communistes dans leurs pays respectifs.
Le premier congrès du Komintern se tint à Moscou du 2 au 6 mars 1919. Il visait à unifier les différents courants révolutionnaires de la planète. Seuls 52 délégués y participèrent, du fait des difficultés que représentait le voyage vers la capitale soviétique en pleine guerre civile, mais aussi parce que le processus de radicalisation n’en était encore qu’à ses débuts. Ce congrès fut donc avant tout un appel aux armes, la création d’un point de référence pour cette aile gauche révolutionnaire qui émergeait à l’échelle internationale, tandis que se développait le processus de la révolution mondiale.
Le congrès publia un manifeste – rédigé par Léon Trotsky – qui n’hésitait pas à proclamer :
« [La classe ouvrière] doit instituer l’ordre véritable, l’ordre communiste. Elle doit briser la domination du capital, rendre les guerres impossibles, effacer les frontières entre les Etats, transformer le monde en une vaste communauté travaillant pour elle-même, réaliser la solidarité fraternelle et la libération des peuples. » [Léon Trotsky et al., Manifeste et résolution de l’Internationale communiste, Editions Clarté, 1919, p.25]
Un des principaux objectifs du congrès était de se distinguer clairement des réformistes de la Deuxième internationale, y compris du « centre » de Kautsky. Bon nombre de discussions portèrent donc sur la reconnaissance de la « dictature du prolétariat » et de la démocratie soviétique – c’est-à-dire du pouvoir ouvrier – à laquelle les réformistes étaient hostiles.
Le congrès permit de lever l’étendard de la révolution mondiale, pour qu’il soit visible par tous les travailleurs de la planète. La jeune Internationale communiste devait devenir un point de référence pour des millions d’entre eux durant les luttes tumultueuses qui suivirent.
Radicalisation accélérée
La lutte des classes se développe sur des décennies, mais la conscience de la classe ouvrière connaît parfois des transformations rapides. En Grande-Bretagne, le nombre de journées de travail perdues pour cause de grève passa de 35 millions en 1919 à 86 millions en 1921. Les syndicats passèrent de 4,1 millions de membres en 1914 à 8,3 millions en 1920. Dans le même temps, le soutien au Parti travailliste connut une nette augmentation.
En Allemagne, il y a eu 3682 grèves en 1919. En 1922, elles étaient 4348. Les syndicats socialistes passèrent de 1,8 million de membres en 1918 à 5,5 millions en 1919 – un saut de presque 4 millions en un an. En 1920, le total des syndiqués – pas seulement dans les syndicats socialistes – atteignit les 10 millions d’inscrits. Il s’agissait d’une expression statistique de la révolution qui avait éclaté en 1918.
En Italie, la CGL – la confédération syndicale socialiste – passa de 250 000 membres en 1918 à 2,1 millions en 1920. Dans le même temps, les effectifs du Parti Socialiste Italien (PSI) furent multipliés par plus de trois, de 60 000 en 1918 à 210 000 en 1920. Ces deux années furent marquées par une vague de grèves massive, qui culmina avec l’occupation des usines en septembre 1920.
On trouve des chiffres similaires dans de nombreux autres pays. Les syndicats connurent partout une croissance exponentielle tandis que les effectifs des partis ouvriers augmentaient considérablement.
Dans le même temps, les dirigeants des syndicats jouaient partout un rôle conservateur et retenaient les travailleurs en arrière, tandis que les chefs politiques du mouvement ouvrier trahissaient ouvertement.
Cette expérience généra de puissants courants de gauche au sein des partis socialistes. C’est de ces courants qu’émergèrent plusieurs des principaux partis communistes d’Europe : en Allemagne, en France et en Italie.
Ce processus ne se déroula pas partout de la même manière. En France, en Italie et en Allemagne, les forces de masse des partis communistes vinrent de la vieille social-démocratie.
Ailleurs, par exemple en Grande-Bretagne, les sections nationales de l’Internationale communiste furent constituées par la fusion de petits groupes révolutionnaires. Dans la plupart des pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie – comme en Chine – les partis communistes furent construits à partir de petits noyaux de cadres.
La France
Les militants du parti socialiste français (Section française de l’internationale ouvrière – SFIO) ressentirent le double effet de la crise en France et de la Révolution russe. Le parti tint deux congrès en 1920 : un en avril, qui chargea une délégation de visiter la Russie soviétique, et un autre à Tours à la fin du mois de décembre.
Ludovic-Oscar Frossard, secrétaire général de la SFIO, et Marcel Cachin, nouveau rédacteur en chef de L’Humanité (le journal du parti), appelaient à rejoindre sans condition l’Internationale communiste. Une fraction de droite dirigée par l’influent député Léon Blum s’y opposait. Un troisième courant, représenté par Jean Longuet, souhaitait adhérer au Komintern, mais sous « certaines conditions » – c’est-à-dire sans adhérer complètement au programme et aux principes de l’Internationale.
Lors du congrès, les délégués entendirent ces différentes positions, et une majorité d’entre eux – 3252 contre 1022 – vota pour adhérer à l’Internationale communiste. La jeunesse du parti avait déjà décidé d’adhérer à l’Internationale communiste de la jeunesse quelques mois auparavant.
Quelques mois plus tard, le parti prit le nom de « Parti Communiste – Section Française de l’Internationale Communiste » (PC-SFIC), avec 110 000 adhérents. Léon Blum scissionna pour fonder une nouvelle SFIO, avec seulement 40 000 militants.
L’Italie
En Italie, le PSI adhéra officiellement à l’Internationale communiste en mars 1919. Son congrès d’octobre 1919 à Bologne appela même à la formation de Soviets en Italie et au renversement de la démocratie bourgeoise. Mais ce n’étaient que des mots : le parti ne fit rien de concret pour appliquer ces décisions.
Le congrès de Bologne exprimait seulement les aspirations de la base, aspirations que les dirigeants réformistes et centristes du parti réfrénaient en permanence.
En septembre 1920, la trahison des réformistes lors de l’occupation des usines accéléra le processus de différenciation interne entre l’aile véritablement révolutionnaire du parti et les éléments centristes et réformistes vacillants.
Lors du congrès de Livourne, le 15 janvier 1921, le parti débattit principalement des « 21 conditions » – les Conditions d’admission des Partis dans l’Internationale communiste que le deuxième congrès du Komintern avait adoptées pour se prémunir des opportunistes. Ces conditions réclamaient explicitement l’exclusion de l’aile réformiste du parti et ses dirigeants, en particulier Filippo Turati et Giuseppe Modigliani.
Amedeo Bordiga – qui allait devenir le chef du Parti communiste – se prononça pour l’adoption intégrale des 21 conditions. Giacinto Serrati, le dirigeant du courant centriste majoritaire au sein du parti, s’y opposa.
Trois résolutions furent soumises au congrès. Celle de Serrati recueillit 100 000 voix, celle de la droite 15 000, et celle des communistes 58 000.
Les communistes quittèrent alors le congrès, en chantant L’Internationale. Ils se rendirent au Teatro San Marco pour fonder le Partito Comunista d’Italia (PCd’I), section italienne de l’Internationale communiste.
L’Allemagne
En Allemagne, les choses ne se passèrent pas aussi directement qu’en France et en Italie. Mais le processus fut globalement le même : l’essentiel des militants du Parti communiste d’Allemagne (KPD) vint de la masse des adhérents du vieux SPD, qui avait énormément grandi lors des événements révolutionnaires du lendemain de la guerre.
Au départ, les éléments révolutionnaires au sein du SPD avaient formé le groupe « Internationale » et étaient connus sous le nom de « spartakistes ». En avril 1917, une scission importante donna naissance au parti socialiste « indépendant », l’USPD. Les Spartakistes participèrent à la scission et rejoignirent l’USPD, mais décidèrent de le quitter à l’éclatement de la Révolution allemande, en novembre 1918, pour fonder un parti communiste.
En réaction au réformisme du SPD et à l’opportunisme de la majorité des dirigeants de l’USPD (dont Kautsky), le KPD était à sa naissance profondément infecté d’idées gauchistes. Il décida par exemple de boycotter les syndicats et refusa de participer aux élections à l’Assemblée constituante de janvier 1919. Ses militants étaient enclins à l’aventurisme, comme le montre le « soulèvement spartakiste » prématuré de janvier 1919. Après que ses deux principaux dirigeants, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, aient été assassinés au lendemain de cette aventure, il restait peu de dirigeants expérimentés capables de corriger les tendances gauchistes du parti.
Entre temps, l’USPD – le « SPD indépendant » – était devenu une force majeure, avec 300 000 militants en mars 1919, puis 800 000 en avril 1920.
La radicalisation massive de la classe ouvrière s’exprima à travers les « Indépendants ». Lors du congrès d’octobre 1920 de l’USPD d’octobre 1920, la majorité du parti accepta les 21 conditions, vota pour l’adhésion à l’Internationale communiste et pour la fusion avec le KPD. Cela provoqua la scission de son aile droite mais donna naissance au plus grand parti communiste hors d’Union soviétique, avec 500 000 militants.
La Grande-Bretagne
Les exemples français, italien et allemand montrent comment des partis communistes de masse ont pu émerger de l’aile gauche de la vieille social-démocratie. Le parti communiste britannique fut, quant à lui, formé par la fusion de petits groupes marxistes, comme le Parti socialiste britannique, le Groupe d’unité communiste du Parti travailliste socialiste, et la Société socialiste de Galles du Sud. Ils furent rejoints, un an plus tard, par le Parti travailliste communiste écossais.
Comme en Allemagne et en Italie, le parti fut initialement imprégné de tendances gauchistes. Un certain nombre de ses militants pensaient que les communistes devaient rejeter le travail parlementaire et se tenir à l’écart du Parti travailliste.
Mais, que ces militants le veuillent ou non, la masse des travailleurs britanniques continuait de considérer le Parti travailliste comme son point de référence. C’est pourquoi Lénine consacra une partie de son livre La Maladie infantile du communisme : le gauchisme à éduquer les communistes britanniques et à les réorienter pour qu’ils se tournent vers le Parti travailliste et dans sa périphérie. Une session entière du second congrès de l’Internationale communiste fut consacrée à cette question.
Le second congrès
La composition et les travaux du deuxième congrès du Komintern – du 19 juillet au 7 août 1920 – reflétèrent la radicalisation d’une couche croissante de la classe ouvrière mondiale. Alors que le premier congrès avait permis de rassembler surtout de petits groupes communistes, le deuxième congrès comptait 218 délégués de 54 partis et organisations à travers le monde et s’attacha à clarifier le programme et les tactiques de la nouvelle internationale.
L’engouement pour le Komintern dans les rangs des partis socialistes posait un danger. De vieux dirigeants et bureaucrates réformistes pouvaient adhérer à l’Internationale aux côtés de leurs militants – pour essayer de conserver leur autorité et leurs positions.
Par exemple, le Parti socialiste italien (PSI) avait adhéré en bloc à l’Internationale communiste, sous la pression de la base du parti, qui s’était radicalisée durant les intenses luttes de classes des années 1918-1920. Mais l’aile réformiste de Turati et Modigliani était toujours dans le parti et travaillait contre les idées révolutionnaires de l’Internationale.
Ce problème fut porté à l’attention du deuxième congrès dès son commencement. Une série de discussions porta sur le rôle des partis communistes, sur les soviets, et sur les méthodes de travail dans le but de distinguer nettement le programme des communistes de celui des réformistes. Lénine rédigea lui-même les 21 conditions pour récapituler ces différences :
« De plus en plus souvent, des Partis et des groupes qui, récemment encore, appartenaient à la IIe Internationale et qui voudraient maintenant adhérer à l’Internationale Communiste s’adressent à elle, sans pour cela être devenus véritablement communistes. La IIe Internationale est irrémédiablement défaite. Les partis intermédiaires et les groupes du “centre” voyant leur situation désespérée, s’efforcent de s’appuyer sur l’Internationale communiste, tous les jours plus forte, en espérant conserver cependant une “autonomie” qui leur permettrait de poursuivre leur ancienne politique opportuniste ou “centriste”. L’Internationale communiste est, d’une certaine façon, à la mode. »
« Le désir de certains groupes dirigeants du “centre” d’adhérer à la IIIe Internationale nous confirme indirectement que l’Internationale communiste a conquis les sympathies de la grande majorité des travailleurs conscients du monde entier et constitue une puissance qui croît de jour en jour. »
« L’Internationale communiste est menacée de l’envahissement de groupes indécis et hésitants qui n’ont pas encore pu rompre avec l’idéologie de la IIe Internationale. » [Vladimir Lénine, « Les conditions d’admission à l’Internationale communiste », Œuvres complètes, volume 31, Editions du Progrès, 1961, p.210] [Nous soulignons]
Pour protéger la nouvelle internationale de cette contamination, la septième condition interdisait explicitement à « des réformistes avérés, tels que Turati, Kautsky, Hilferding, Longuet, Mac Donald, Modigliani et autres, [...] de se considérer comme des membres de la IIIe Internationale. » [Ibid.] Cette mesure visait les sociaux-traîtres incorrigibles et les conciliateurs réformistes qui avaient pu adhérer à des sections de l’Internationale communiste.
Le programme et les méthodes
Les débats du deuxième congrès permirent d’approfondir une série de questions importantes.
Lénine s’attacha par exemple à expliquer en quoi les gauchistes se trompaient lorsqu’ils envisageaient un « effondrement imminent du capitalisme ». Il avertit les délégués du congrès : les capitalistes avaient beau être aux prises avec des crises révolutionnaires dans de nombreux pays, ils trouveraient toujours un moyen de s’en sortir, tant qu’ils parviendraient à se maintenir au pouvoir. L’issue de la lutte dépendrait des partis révolutionnaires de chaque pays. Rien ne garantissait a priori la victoire de la révolution.
Lénine consacra aussi beaucoup d’attention à d’autres questions théoriques cruciales. Il rédigea (et amenda) les Thèses sur les questions nationale et coloniale du deuxième congrès. Ces Thèses marquaient une rupture nette avec les positions souvent ambiguës des partis de la Deuxième internationale, dans lesquels les réformistes de droite justifiaient le colonialisme au nom de « la mission civilisatrice de l’Europe », et soutenaient donc les ambitions impérialistes de leurs bourgeoisies nationales.
L’Internationale communiste se plaça fermement dans le camp des peuples opprimés et colonisés. Elle exhortait les classes ouvrières des pays avancés à soutenir les luttes anti-impérialistes de ces peuples et distinguait clairement les nations oppressives des nations opprimées. S’il n’avait pas adopté cette position de principe sur le colonialisme, le Komintern n’aurait jamais pu construire de sections dans les pays colonisés. C’est encore un exemple du rôle crucial que jouent les idées dans la construction d’une organisation.
En Chine – qui était alors une semi-colonie – ces idées jouèrent un rôle important pour unir les forces fondatrices du Parti communiste. Ses premiers cadres commencèrent par former un groupe d’étude marxiste à l’Université de Pékin, autour du professeur Chen Duxiu.
C’est ce groupe d’intellectuels qui fonda le Parti communiste chinois en juillet 1921. Les douze délégués qui participèrent au congrès de fondation représentaient un total de 59 membres.
Leurs forces extrêmement réduites ne les empêchèrent pas de se présenter comme un parti – un parti qu’ils construisirent en partant littéralement de zéro. En mai 1925, leur petit groupe initial était déjà parvenu à rassembler un millier de membres, principalement des étudiants et des intellectuels.
Un événement historique de première importance, la révolution chinoise de 1925-1927, vint accélérer ce processus et ouvrir d’immenses possibilités pour le parti. Des dizaines de milliers d’ouvriers affluèrent dans ses rangs. En deux ans, le parti atteignit les 60 000 membres.
La Révolution russe avait eu un impact immense à travers toute la planète. Des partis et groupes communistes commencèrent à apparaître dans de nombreux autres pays, notamment au Moyen-Orient et en Amérique latine. Souvent fondés au départ par de petits cercles d’intellectuels, ils commencèrent ensuite à se connecter à de plus larges couches de travailleurs.
Contre le gauchisme
L’Internationale communiste était parvenue à rallier autour de son drapeau une vaste couche de travailleurs et de jeunes combatifs, dont une bonne partie avait été radicalisée par les récents événements. Mais beaucoup d’entre eux – y compris les dirigeants des jeunes partis communistes – n’avaient aucune expérience de la méthode et des tactiques du marxisme.
Ces nouveaux communistes étaient souvent animés par un rejet sain de l’opportunisme de la Deuxième internationale, qui s’était adaptée au parlementarisme. De même, ils étaient généralement révoltés par le rôle des dirigeants syndicaux réformistes, qui freinaient le mouvement. Mais cela conduisit une partie d’entre eux à tirer la conclusion erronée que le « bolchevisme » se résumait à l’intransigeance révolutionnaire et au refus de tout compromis. Ils pensaient que, pour construire des partis communistes, il suffisait de dénoncer la démocratie bourgeoise et de construire des syndicats purement « révolutionnaires ». Le communiste néerlandais Herman Gorter alla jusqu’à accuser Lénine d’« opportunisme », parce qu’il recommandait de mener un travail au sein du Parlement et dans les syndicats.
Lénine qualifiait cette attitude de « gauchiste », ou « ultragauchiste ». Il soulignait qu’il ne suffisait pas de dénoncer le capitalisme et d’attendre que les masses rejoignent le parti révolutionnaire. Il faut gagner les masses, et cela nécessite de faire preuve de la plus grande souplesse tactique. C’était la leçon centrale de toute l’histoire du Parti bolchevik.
Lénine comprenait que si ces erreurs sectaires n’étaient pas rapidement corrigées, les sections de l’Internationale communiste risquaient d’être détruites, fracassées sur les écueils de la révolution elle-même. Il considérait néanmoins qu’il s’agissait d’erreurs « infantiles », c’est-à-dire un produit de l’immaturité de ces partis, et qu’elles pouvaient être corrigées par des explications et des discussions patientes.
C’est dans ce but que Lénine écrivit La maladie infantile du communisme : le gauchisme, en avril-mai 1920, en prévision du deuxième congrès du Komintern. Il y résumait les leçons de l’histoire du Parti bolchevik, apprises à travers sa participation à trois révolutions entre 1905 et 1917 et son expérience du pouvoir, et mettait en garde contre les deux dangers de l’opportunisme et du gauchisme.
Ce livre fut publié en allemand, en anglais et en français, pour que tous les délégués du deuxième congrès puissent le lire. L’attention que Lénine porta personnellement à la mise en forme et à l’impression de l’ouvrage témoigne de l’importance qu’il y accordait. Il voulait être absolument certain qu’il soit publié avant l’ouverture du congrès.
Lénine et Trotsky cherchaient à clarifier les idées et les tactiques du véritable communisme à travers des explications et des débats patients, notamment pendant les congrès de l’Internationale communiste. C’est à ce titre qu’ils écrivirent de longs documents de congrès, présentèrent des rapports et prirent la parole durant les débats sur les questions fondamentales.
Comme le montre cet exemple, Lénine cherchait généralement à résoudre les problèmes politiques par des méthodes politiques, plutôt que par des mesures organisationnelles.
Il y consacrait beaucoup de temps, car il savait qu’on ne peut pas convaincre et éduquer de vrais communistes révolutionnaires, des communistes capables de réfléchir, en leur apprenant seulement à obéir. Cela ne produit que des « imbéciles obéissants », incapables de s’orienter par eux-mêmes dans le feu de la lutte des classes et de la révolution.
Les syndicats
Les deuxième et troisième congrès discutèrent aussi longuement de la question syndicale. Les Thèses sur le mouvement syndical, les comités de fabrique et d’usines du deuxième congrès expliquent clairement que :
« […] pendant la guerre, les syndicats se présentèrent le plus souvent en qualité d’éléments de l’appareil militaire de la bourgeoisie ; ils aidèrent cette dernière à exploiter la classe ouvrière avec la plus grande intensité et à faire mener la guerre de la manière la plus énergique, au nom des intérêts du capitalisme. N’englobant que les ouvriers spécialisés les mieux rétribués par les patrons, n’agissant que dans des limites corporatives très étroites, enchaînés par un appareil bureaucratique, complètement étranger aux masses trompées par leurs leaders opportunistes, les syndicats ont non seulement trahi la cause de la Révolution sociale, mais aussi celle de la lutte pour l’amélioration des conditions de la vie des ouvriers qu’ils avaient organisés. » [« Le mouvement syndical, les comités de fabriques et d’usines », Statuts et résolutions de l’Internationale communiste, Bibliothèque communiste, 1920, pp.53-54]
Mais après ce constat franc et net, les mêmes Thèses signalent que :
« […] les larges masses ouvrières qui demeuraient jusqu’à présent en dehors des syndicats y affluent maintenant. On constate dans tous les pays capitalistes une croissance prodigieuse des syndicats qui ne représentent plus maintenant l’organisation des seuls éléments avancés du prolétariat, mais celle de toute sa masse. En entrant dans les syndicats, les masses cherchent à en faire leur arme de combat. »
« L’antagonisme des classes devenant toujours de plus en plus aigu force les syndicats à organiser des grèves dont la répercussion se fait sentir dans le monde capitaliste tout entier, en interrompant le processus de la production et de l’échange capitalistes. En augmentant leurs exigences à mesure qu’augmente le prix de la vie et qu’elles-mêmes s’épuisent de plus en plus, les masses ouvrières détruisent par cela même tout calcul capitaliste qui représente le fondement élémentaire d’une économie organisée. Les syndicats, qui étaient devenus pendant la guerre les organes de l’asservissement des masses ouvrières aux intérêts de la bourgeoisie, représentent maintenant les organes de la destruction du capitalisme. » [Ibid., pp.54-55] [Nous soulignons].
C’est là un exemple de la méthode dialectique de Lénine. Elle permet aux communistes de voir comment les choses, lorsqu’elles se développent et se transforment, peuvent se changer en leur contraire. Les syndicats subissaient la pression de deux intérêts de classes opposés.
D’une part, les capitalistes cherchaient consciemment à corrompre les dirigeants syndicaux, afin de pouvoir les utiliser pour contrôler la classe ouvrière. D’autre part, la base des syndicats se radicalisait de plus en plus, alors que des masses de travailleurs, sous les coups de l’inflation et de l’aggravation des conditions de travail, réclamaient que leurs dirigeants les défendent.
C’est pourquoi les thèses affirmaient qu’il fallait « que les communistes de tous les pays fassent partie des syndicats » et condamnaient toutes les tentatives de boycott des syndicats ou d’organisation de syndicats alternatifs comme un « danger énorme pour le mouvement communiste ». Une telle tactique, disaient-elles, « écarte de la masse les ouvriers les plus avancés, les plus conscients, et les pousse vers les chefs opportunistes travaillant pour les intérêts de la bourgeoisie ». [Ibid. pp. 56-57]
Comme pour toute déclaration de ce type, le risque est toujours présent d’une interprétation trop mécanique et unilatérale. Le principe de participation des communistes aux syndicats n’excluait absolument pas que des scissions puissent parfois être nécessaires.
La méthode de Lénine était souple et tenait toujours compte des conditions concrètes auxquelles les communistes étaient confrontés. C’est pourquoi le même document précise un peu plus loin que « les communistes […] ne doivent pas hésiter devant les scissions qui pourraient se produire au sein des organisations syndicales si, pour les éviter, il était nécessaire d’abandonner le travail révolutionnaire », tout en ajoutant que :
« Dans le cas où une scission deviendrait inévitable, les communistes devraient accorder une grande attention à ce que cette scission ne les isole pas de la masse ouvrière. » [Ibid. p. 58]
Le troisième congrès discuta aussi d’une Résolution concernant les formes et les méthodes du travail communiste parmi les femmes, qui définissait les méthodes spéciales que les Partis communistes devaient appliquer dans ce champ de leur activité.
Il souligna enfin l’importance de la radicalisation qui s’opérait au sein de la jeunesse, et fit de l’Internationale des jeunes communistes une partie intégrante du Komintern, soumise à sa discipline, et non plus une entité distincte.
Les crises et la conscience
Les congrès de l’Internationale communiste débattaient des hauts et des bas de la lutte des classes à l’échelle mondiale. Ils eurent notamment à traiter de l’importante question de la relation entre les cycles économiques et la lutte des classes.
Une façon simpliste et mécanique d’envisager cette relation serait de penser que chaque période de récession ferait augmenter la lutte des classes et chaque période de croissance renforcerait la stabilité du système. Les dirigeants de l’Internationale mirent en garde les sections nationales contre une telle interprétation, qui pouvait déboucher sur de sérieuses erreurs d’évaluation. Ils tentèrent de transmettre leur expérience théorique aux dirigeants et aux militants des partis communistes.
Cette question prit une importance particulière lors du troisième congrès du Komintern, du 22 juin au 12 juillet 1921. Les premières années de l’après-guerre avaient été marquées par une crise du capitalisme et une vague révolutionnaire en Europe. Mais en 1921, le système avait réussi à se stabiliser, du fait des trahisons des réformistes. Ce rebond économique désorienta certains dirigeants communistes, qui avaient une approche mécanique de la dynamique de la lutte des classes.
Dans son Rapport sur la crise économique mondiale et les nouvelles tâches de l’Internationale communiste, Trotsky expliqua :
« Il serait faux et injuste d’expliquer […] que les crises provoquent toujours une action révolutionnaire et que le relèvement a, au contraire, le don de calmer la classe ouvrière. » [Léon Trotsky, « Rapport sur la crise économique mondiale et les nouvelles tâches de l’Internationale communiste », Nouvelle étape, Librairie de l’Humanité, 1922, p.50]
Trotsky basait son rapport sur l’expérience des flux et reflux de la lutte des classes au début du XXe siècle en Russie. Répondait aux simplifications abusives, il affirmait :
« De nombreux camarades disent que si un relèvement avait lieu dans la période, il serait fatal pour notre révolution. Non, en aucun cas. En règle générale, il n’y a pas de dépendance automatique entre le mouvement révolutionnaire prolétarien et les crises. Il s’agit d’une interaction dialectique. » [L Trotsky, « Report on the World Economic Crisis and the New Tasks of the Communist International », The First Five Years of the Comintern, Wellred Books, 2020, pg 277, traduction originale] [Nous soulignons]
Trotsky soulignait qu’il existe des moments où une grave crise économique peut en réalité affaiblir la combativité des travailleurs. Ce n’est que lorsque l’économie commence à se rétablir que les travailleurs regagnent confiance dans leur force par rapport aux patrons, et donc – d’une façon qui peut sembler paradoxale – s’engagent dans des luttes plus combatives. Les effets de la croissance et des récessions sur la lutte des classes ne sont ni immédiats, ni mécaniques. Ils peuvent être retardés, en fonction du contexte et des événements qui les ont précédés.
Trotsky concluait que les capitalistes étaient en train d’essayer de parvenir à un nouvel équilibre économique, mais que, ce faisant, ils menaçaient l’équilibre social et politique. L’accalmie dans la lutte des classes finirait inévitablement par laisser la place à une résurgence de la révolution mondiale. La tâche du Komintern était donc de se préparer pour la prochaine vague, en construisant de puissants partis communistes, au moyen de tactiques permettant de gagner les masses.
La « théorie de l’offensive »
Cette discussion était particulièrement importante dans le contexte de l’« Action de mars » que les communistes allemands avaient menée cette année-là.
L’Allemagne était plongée depuis 1918 dans une vague de révolution et de contre-révolution. Le KPD était alors le plus grand parti communiste hors de Russie, avec plus de 500 000 membres.
En mars 1921, alors que la révolution refluait, la direction du KPD tenta de provoquer artificiellement une nouvelle vague révolutionnaire, et ce uniquement à travers l’activité du parti. Certains de ses militants allèrent même jusqu’à faire sauter le siège d’une coopérative ouvrière pour en accuser la police.
Cette initiative découlait de la soi-disant « théorie de l’offensive ». Une couche de militants gauchistes affirmait que les partis communistes devaient mener une « tactique offensive » – quelle que soit la situation objective – pour entraîner les travailleurs dans la révolution.
Le mouvement réel de la classe ouvrière n’entrait même pas en ligne de compte dans leurs plans. L’« action » tourna donc au désastre. Des milliers de militants furent arrêtés, le KPD fut interdit et plus de 200 000 personnes quittèrent le parti ou devinrent inactives.
Mais une couche de gauchistes au sein du KPD continuait de défendre cette tactique. Ils étaient soutenus par des dirigeants du Komintern comme Radek, Boukharine et Zinoviev, eux aussi partisans de la « théorie de l’offensive ». Les « communistes de gauche » de Hongrie, de Tchécoslovaquie, d’Italie, d’Autriche et de France faisaient tous l’éloge de l’« action de mars », qu’ils décrivaient comme un modèle héroïque.
Il revint donc à Lénine et Trotsky de corriger cette déviation gauchiste lors du troisième congrès du Komintern. Ils expliquèrent que le courage et l’héroïsme des communistes ne suffisent pas en eux-mêmes pour diriger une révolution. Il leur faut gagner les masses.
Pour y parvenir, les partis communistes avaient besoin de dirigeants capables d’analyser la situation objective et de déterminer à quelle étape du processus révolutionnaire ils se trouvaient. D’où l’importance d’une compréhension dialectique de la lutte des classes et d’une capacité à comprendre à chaque étape l’état de la conscience des masses.
On ne peut pas créer ex nihilo une situation révolutionnaire. Plutôt que d’essayer d’ordonner aux masses de se mobiliser, les partis communistes devaient apprendre à dialoguer avec elles. Cela implique de savoir se connecter à leur niveau réel de conscience, pour pouvoir l’élever jusqu’à la réalisation de la nécessité de la prise du pouvoir. Ce n’est que lorsque la situation révolutionnaire a pleinement mûri et que les communistes ont gagné la majorité de la classe ouvrière, qu’il devient possible de mener une insurrection victorieuse.
En conclusion de cette discussion, Trotsky remarqua que « seul un simple d’esprit peut réduire à l’offensive toute la stratégie révolutionnaire. » [Léon Trotsky, « Rapport sur la crise économique mondiale et les nouvelles tâches de l’Internationale communiste », Nouvelle étape, Librairie de l’Humanité, 1922, p.118] L’art de diriger, ce n’est pas seulement savoir ordonner d’avancer, mais aussi savoir quand il faut battre en retraite. Cela peut faire la différence entre une retraite en bon ordre, qui permet de préserver les forces pour de futures batailles, et une déroute complète.
Le congrès se rangea finalement à la position de Lénine et Trotsky, et adopta le slogan « Aux masses ! ».
Le front unique
Les dirigeants comme Lénine et Trotsky tentaient d’améliorer les capacités de compréhension des militants de l’Internationale communiste, à commencer par les directions des sections. Ils essayèrent en particulier de leur enseigner comment le parti révolutionnaire, ayant gagné les couches avancées – l’avant-garde de la classe ouvrière – peut conquérir les masses encore influencées par les dirigeants réformistes du mouvement.
Les grands événements historiques entraînent de larges couches des masses dans l’arène de la lutte. Dans ce processus, celles-ci commencent à mettre leurs dirigeants à l’épreuve. Les dirigeants syndicaux qui refusent de combattre ou qui utilisent leur autorité pour freiner les travailleurs finissent par être écartés et remplacés par d’autres plus combatifs. Sur le plan politique, les travailleurs se mettent à la recherche de dirigeants qui proposent – ou semblent proposer – une réponse à la crise du système, des dirigeants prêts à mener la lutte contre le système.
Cela ne se joue pas en une fois : il n’y a pas de « big bang » dans le développement de la conscience révolutionnaire. Ce processus se développe à travers une série d’événements durant une période d’instabilité, avec des hauts et des bas – des explosions d’intense lutte des classes suivies de périodes de reflux – qui finissent par produire des bonds dans la conscience.
Différentes couches de la classe ouvrière évoluent aussi chacune à des rythmes différents. Des couches plus avancées commencent à tirer des conclusions révolutionnaires avant le reste de la classe. Ce sont ces couches que le parti révolutionnaire doit gagner pour les organiser, les éduquer, et les orienter vers la masse de la classe ouvrière.
Il est impossible pour le parti révolutionnaire de gagner les masses en période de croissance prolongée du système capitaliste, c’est-à-dire quand le système parvient à accorder des concessions à la classe ouvrière. Durant ces périodes, c’est le réformisme qui domine. Ce fut le cas à la fin du XIXe siècle et durant les premières années du XXe siècle. Après tout, si le capitalisme semble fonctionner, à quoi bon le renverser ?
Durant ces périodes, les marxistes authentiques sont réduits à de petits groupes qui doivent nager à contre-courant et conserver leurs forces pour préserver les idées du marxisme révolutionnaire. Quand le système recommence à entrer en crise après ces longues périodes, les travailleurs tendent tout d’abord à chercher à revenir au « bon vieux temps », sans réaliser immédiatement que la révolution est nécessaire. La conscience humaine est généralement conservatrice : il lui faut du temps pour rattraper la réalité objective.
Tout cela explique que, dans les premiers temps, l’aile révolutionnaire du mouvement soit minoritaire, tandis que la majorité de la classe ouvrière cherche des voies apparemment plus faciles, plus « réalistes ». C’est pour cela que ce sont initialement les dirigeants réformistes qui ont la plus grande influence sur les masses.
C’est pourquoi les Thèses sur l’unité du front prolétarien furent soumises à l’approbation du quatrième congrès, qui se tint du 5 novembre au 5 décembre 1922. Elles notaient que « les illusions réformistes […] avaient bénéficié d’un regain de faveur » et qu’il existait « une tendance spontanée à l’unité » au sein de la classe ouvrière. [« Thèses sur l’unité du front prolétarien », IVe Congrès communiste mondial – Résolutions, Librairie de l’Humanité, 1923, p.92] La situation objective avait considérablement changé. Comme l’avait noté le précédent congrès, la vague révolutionnaire était en reflux, et le système était en train de se stabiliser temporairement. Les Thèses faisaient le constat suivant :
« […] portés par une confiance croissante vers les éléments les plus irréductibles, les plus combatifs de leur classe – vers les communistes – les travailleurs témoignent plus que jamais d’un irrésistible désir d’unité. Eveillées désormais à une vie plus active, les couches les moins expérimentées de la classe ouvrière rêvent de la fusion de tous les partis ouvriers, sinon de toutes les organisations prolétariennes. Elles espèrent accroître ainsi leur capacité de résistance à la poussée capitaliste. » [Ibid. p.93]
Dans ce contexte, les partis réformistes comme le Parti travailliste britannique, le SPD allemand et le PSI italien contrôlaient encore de vastes couches de la classe ouvrière. La question restait donc posée de savoir comment gagner ces couches aux idées du communisme révolutionnaire ? Il était impossible d’y arriver à travers une attitude sectaire ou en se contentant de dénonciations des trahisons passées des réformistes. Il fallait appliquer intelligemment la tactique du front unique ouvrier.
L’idée générale de cette tactique était la suivante : pour gagner la confiance de la base des organisations et syndicats réformistes, il fallait montrer que les communistes étaient prêts à lutter au sein d’un front unique de la classe ouvrière. Celui-ci devait combattre pour les intérêts immédiats de la classe ouvrière, mettre sous pression les dirigeants réformistes et défendre les intérêts les plus généraux de la classe dans son ensemble.
A travers ces luttes quotidiennes, il serait possible de démontrer par la pratique que les communistes étaient les combattants les plus résolus, de mettre à l’épreuve les dirigeants partisans de la collaboration de classe, et de gagner les militants de base au programme révolutionnaire des communistes, à la nécessité de la révolution socialiste.
La tactique du front unique fut appliquée de différentes façons selon les pays, en fonction des conditions locales et du rapport de forces entre les partis communistes et les organisations réformistes de masse. Mais l’idée principale restait la même.
En Italie, cela se traduisait par la mise sur pied d’une résistance face à la menace croissante de la réaction. Mussolini avait été nommé Premier ministre par le roi en octobre 1922. Le Front unique supposait donc que le PCd’I propose une action unitaire au Parti socialiste et aux syndicats pour s’opposer à la violence des fascistes.
En Grande-Bretagne, au vu des faibles forces du Parti communiste, les Thèses affirmaient :
« Il est maintenant du devoir des communistes d’exiger par une campagne énergique, leur admission dans le Labour Party. […] Les communistes doivent s’efforcer à tout prix de pénétrer au plus profond des masses laborieuses sous le mot d’ordre de l’unité du front prolétarien contre la bourgeoisie. » [Ibid. p. 97]
Néanmoins, les Thèses précisaient que « pour appliquer avec succès la tactique préconisée, il importe que le parti soit fortement organisé et que sa direction se distingue par la clarté parfaite de ses idées. » [Ibid. pp. 102-103] C’est la tâche centrale que s’étaient donnée Lénine et Trotsky lors des congrès de l’Internationale.
Malheureusement, ils n’y parvinrent pas toujours. La qualité, le niveau politique et les capacités d’analyse de nombre de dirigeants des jeunes partis communistes n’étaient pas à la hauteur des tâches auxquelles ils faisaient face.
Au sein de la direction du Parti communiste d’Italie, des figures comme Bordiga s’obstinèrent à rejeter les conseils de Lénine et Trotsky. Bordiga contribua ainsi à une tragique division des forces de la classe ouvrière italienne, précisément au moment où la bourgeoisie passait à l’offensive. La classe dirigeante s’apprêtait à détruire totalement le mouvement ouvrier italien, à l’atomiser, en assassinant des milliers de dirigeants locaux et en arrêtant les autres, pour finalement établir la dictature du capital sous sa forme la plus brutale : le fascisme.
L’importance de la direction
Ce qui ressort de l’histoire de cette période, c’est que la transformation de petites forces révolutionnaires en partis révolutionnaires de masse a été rendue possible par des changements rapides dans la situation objective. L’éclatement de la Première Guerre mondiale et la grave crise économique qui s’ensuivit, avec un chômage de masse et une inflation élevée, préparèrent le terrain pour des événements révolutionnaires.
Mais sans maîtrise de la théorie révolutionnaire, on peut aussi rater l’occasion de bâtir des partis révolutionnaires de masse.
Les premières années de l’Internationale communiste soulignent aussi l’importance de former les cadres du futur parti révolutionnaire bien avant le début de la révolution, et démontrent l’importance de la direction au sein même du parti révolutionnaire. C’est évident quand on étudie la période qui suit l’éclatement de la révolution de février 1917 en Russie, durant laquelle la pression du réformisme était énorme.
Comme nous l’avons expliqué, aux premières étapes d’une révolution, la masse de la classe ouvrière cherche d’abord la voie qui semble la plus facile, celle du réformisme. C’est pour cette raison que les Mencheviks et les Socialistes-révolutionnaires dominèrent le mouvement au début de 1917. Cela poussa les dirigeants du parti bolchevik présents en Russie, comme Kamenev et Staline, à plier sous la pression et à s’orienter vers une politique de compromis et de soutien au gouvernement provisoire.
Il fallut un dirigeant du calibre de Lénine – un marxiste soigneusement formé, qui comprenait la méthode du marxisme et la nécessité d’appliquer une pensée dialectique – pour réorienter le parti dans la bonne direction et le maintenir sur une position fermement révolutionnaire, même quand cela impliquait d’aller à contre-courant.
Lénine le dialecticien parvint à résister aux pressions dans la période qui suivit février 1917 et à maintenir une position ferme, car il voyait plus loin que les dirigeants bolcheviks locaux. Il comprenait que les chefs mencheviks finiraient inévitablement par trahir, que cela leur ferait perdre le soutien de la classe ouvrière, et que celle-ci serait alors plus ouverte à la position révolutionnaire des bolcheviks. Si Lénine n’avait pas été aux commandes du parti, les bolcheviks n’auraient pas pu saisir l’occasion qui se présenta ensuite en octobre.
L’importance de la direction fut démontrée de façon négative par les défaites des mouvements révolutionnaires en Autriche, en Hongrie, en Allemagne, en Italie et ailleurs. Malheureusement, et pour des raisons diverses, aucun des jeunes partis communistes qui étaient apparus dans cette période ne disposait de dirigeants du niveau de Lénine et Trotsky. D’où l’urgence avec laquelle le Komintern tenta de former de tels dirigeants alors même que le processus révolutionnaire était en cours, tout en corrigeant les différentes erreurs au fur et à mesure qu’elles étaient commises.
La défaite de la révolution en Italie et dans d’autres pays, en particulier en Allemagne, eut un impact dramatique sur l’Union soviétique elle-même. La révolution fut isolée dans un seul pays. Ce fut le facteur principal du processus de dégénérescence bureaucratique du parti bolchevik, qui découlait aussi de l’arriération économique et culturelle de l’URSS à l’époque.
Cette dégénérescence se refléta au sein même de la direction de l’Internationale communiste, surtout à partir de la maladie de Lénine, en mars 1923. L’exécutif du Komintern, autour de Zinoviev, eut de plus en plus recours à des méthodes de commandement bureaucratique vis-à-vis des directions des sections nationales. Au milieu des années 1930, l’Internationale communiste avait finalement cessé d’être l’instrument de la révolution mondiale et était réduite à n’être plus qu’un outil de la politique étrangère de la bureaucratie stalinienne.
Leçons
On peut tirer deux grandes leçons de l’expérience de l’Internationale communiste au temps de Lénine. D’abord, qu’il est essentiel d’être absolument clair en ce qui concerne les idées théoriques. Une grave erreur d’analyse, qu’elle soit d’un caractère opportuniste ou sectaire, peut réduire à néant les forces d’un parti si elle n’est pas corrigée. C’est pourquoi nous consacrons autant de temps et d’énergie à l’éducation de nos rangs.
Les erreurs théoriques peuvent conduire à de graves erreurs pratiques. Le gauchisme des dirigeants du Parti communiste d’Italie en 1921-1924 joua par exemple un rôle nocif en isolant le jeune PCd’I des masses encore influencées par les réformistes du PSI. En Allemagne aussi, de sérieuses erreurs furent commises. Il est donc crucial d’étudier cette période, en même temps que les œuvres classiques de Lénine, pour construire nos forces aujourd’hui.
La deuxième grande leçon est que la rigueur et la fermeté sur le plan théorique doivent aller de pair avec la souplesse tactique. C’était un aspect essentiel de la politique du Parti bolchevik sous Lénine, qui transparaît dans les discussions, les thèses et les résolutions des quatre premiers congrès de l’Internationale communiste – que Trotsky décrivait comme « une école de stratégie révolutionnaire ».
Durant les premières années de l’Internationale communiste, ses sections nationales furent bâties par des voies très diverses, en fonction des conditions objectives concrètes de chaque pays. Nous devons aujourd’hui garder la même attitude quant à la façon dont nous bâtirons nos forces. Ne pas le faire signifierait nous condamner à rater des opportunités.
A mesure que la situation objective sera transformée par la crise du capitalisme et par les intenses luttes de classes qui en découleront, de nombreuses occasions de grandir rapidement s’offriront à nous. Mais pour nous orienter correctement, il nous faudra un parti éduqué, comprenant l’histoire et maîtrisant la théorie marxiste, capable de faire preuve de la souplesse et de l’audace que la situation exigera.
Notre cri de ralliement doit être : Revenons à Lénine ! Construisons dès maintenant des partis communistes révolutionnaires ! En avant vers la révolution socialiste mondiale !