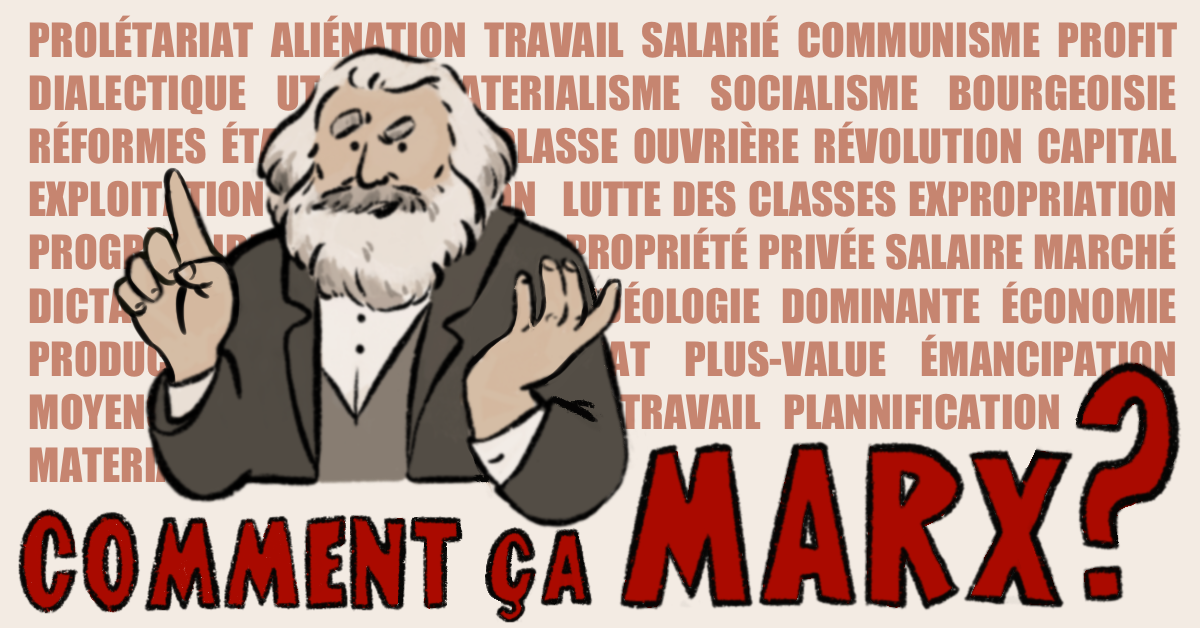D’innombrables professeurs bourgeois ont accusé le marxisme de « réduire à l’économie » toute la vie politique et sociale, c’est-à-dire de prétendre que « tout » est déterminé en permanence par des facteurs économiques (et rien d’autre).
Marx et Engels ont maintes fois protesté contre cette interprétation de leurs idées. Dans une lettre à Joseph Bloch, en 1890, Engels écrivait : « Le facteur déterminant dans l’histoire est, en dernière instance, la production et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx, ni moi n’avons affirmé davantage. Si, ensuite, quelqu’un torture cette proposition pour lui faire dire que le facteur économique est le seul déterminant, il la transforme en une phrase vide, abstraite, absurde. »
Engels souligne les mots « en dernière instance ». Ils signifient que les rapports économiques forment la base du processus historique (ni plus, ni moins). Pour se livrer à des activités politiques, artistiques, religieuses ou autres, les hommes et les femmes doivent d’abord se nourrir, se vêtir, se loger – bref, « produire et reproduire la vie réelle ». Mais cela ne signifie pas que l’économie « est seule active et que tout le reste n’est qu’un effet passif », explique Engels. Les effets deviennent causes : « Les développements politiques, juridiques, philosophiques, religieux, littéraires, artistiques, etc. (…) réagissent tous également les uns sur les autres, ainsi que sur la base économique ». [1]
Deux exemples
C’est la soif de profits des bourgeoisies du monde entier – un facteur éminemment économique – qui a déterminé leur gestion calamiteuse de la crise sanitaire de 2020. Mais la gestion d’une crise sanitaire est aussi une affaire politique. Or elle a eu différents types d’effets : sur le plan politique, elle a aggravé le discrédit des politiciens bourgeois ; sur le plan économique, elle a fait flamber la dette des Etats et nourri l’inflation. A son tour, l’inflation a provoqué des grèves pour des augmentations de salaire. Ici, les facteurs économiques, politiques et sociaux sont étroitement imbriqués, mais c’est la situation économique qui, en dernière instance, est déterminante. S’il n’y avait pas eu le Covid, la crise du capitalisme aurait emprunté une autre voie aboutissant au même résultat : le discrédit croissant des politiciens bourgeois et l’intensification de la lutte des classes.
L’actuelle crise de régime, en France, est un autre exemple frappant de cette interaction entre les différents facteurs. En dernière analyse, cette crise politique s’enracine dans le déclin économique du capitalisme français, son recul sur tous les marchés (mondial, européen et même national). La flambée de la dette publique en est l’une des expressions. Mais en retour, l’impasse politique menace d’aggraver la situation économique, et notamment de précipiter une hausse brutale des taux d’intérêts de la dette française. La grande bourgeoisie en est réduite à tenter de négocier – avec les dirigeants du RN, du PS, des Verts, du PCF et des confédérations syndicales – l’ampleur des coupes budgétaires qui permettraient à la fois de satisfaire les marchés financiers et de garantir un minimum de stabilité politique. Cependant, la crise économique se développe indépendamment du château de cartes parlementaire que Bayrou s’efforce de construire.
Même Beethoven…
Les différents facteurs ne sont pas toujours liés d’une façon aussi serrée. Par exemple, quiconque chercherait à expliquer la structure d’une symphonie de Beethoven à partir de la statistique économique de son temps ne parviendrait qu’à se rendre ridicule. Inversement, les symphonies de Beethoven n’ont pas eu d’impact significatif sur le développement économique de l’époque. Et pourtant, il y a quand même un lien (très indirect, mais réel) entre ces œuvres d’art et la base économique : la musique de Beethoven porte la marque d’une période révolutionnaire, et en particulier de la Grande Révolution française – qui était elle-même déterminée, en dernière instance, par des facteurs économiques.
Au fond de la critique du soi-disant « économisme » marxiste, il y a une bonne dose d’ignorance, mais aussi d’intérêts… économiques. Sous couvert d’objections théoriques, les idéologues bourgeois nous reprochent d’expliquer aux travailleurs que s’ils veulent en finir avec toutes les formes de misère et d’oppression, ils devront prendre collectivement le contrôle de la « base économique », c’est-à-dire des grands moyens de production et d’échange. Et c’est bien en effet ce qu’on explique, parce que c’est vrai.
[1] Lettre à Borgius (F. Engels, 25 janvier 1894).